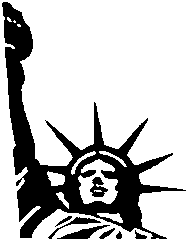| Montréal,
le 4 juillet 1998 |
Numéro
15
|
 (page 7)
(page 7)
 page précédente
page précédente
Vos
commentaires
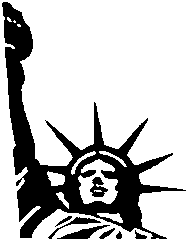
«
On ne devrait jamais laisser quelqu'un crever de faim. Cependant,
l'être humain étant par nature essentiellement égoïste,
je ne crois pas non plus qu'on devrait offrir aux sans-emploi assez d'argent
pour subvenir à tous leurs besoins. Les conditions de vie du chômeur
doivent être dures, et même très dures, afin de le dissuader
de se complaire dans sa situation de chômeur.
J'estime
aussi que ses allocations devraient être conditionnelles à
l'exécution de certains travaux. En offrant au chômeur assez
d'argent pour subvenir à ses besoins sans qu'il ait à travailler,
on l'empêche de se faire valoir dans la société; on
lui enlève sa fierté. Bref, on le rend malheureux.
»
Albert Einstein
|
|
BILLET
SUR LES VERTUS
DE LA MÉTHODE FORTE
par Brigitte Pellerin
Je sais, tout le monde le bougonne là-dessus sans arrêt: les
temps sont durs. Il n’y a pas de jobs, les diplômes ne mènent
que trop souvent au fast-food ou à la vente de téléphones
cellulaires, les adolescents se suicident à la chaîne et les
jeunes retraités de l'État sombrent dans la dépression,
version post-active.
Les pauvres se plaignent des banques, les travailleurs se plaignent des
taxes, les vieux considèrent que les jeunes ont perdu le sens des
« vraies » valeurs, les divorcées courent
après leurs pensions alimentaires, et tout le monde trouve que le
système de santé ressemble de plus en plus à une machine
distributrice qui aurait le piton désespérément collé.
Pour faire une histoire courte, disons que ça va mauditement mal.
N’empêche, des fois je me dis qu’on n'est pas assez sévères.
Pour vous dire la vérité, je nous considère définitivement
trop mous. On ne se dit jamais qu’on pourrait faire mieux, on ne se critique
pas – du moins, pas en pleine poire – et on se réfugie bien vite
devant notre télé en essayant de se consoler comme on peut
avec les catastrophes qui arrivent aux autres. Les tragédies d’outre-mer
ont au moins ceci qu’elles nous font prendre conscience que, malgré
tout ce qu’on peut penser, on est drôlement bien chez nous.
C'est facile de nos jours de se laisser sombrer dans une douillette indifférence.
On lit dans les journaux qu'il y a des enfants qui ne mangent pas à
leur faim, mais on ne sait pas trop où ils sont. On voudrait bien
que la misère humaine disparaisse de la surface du globe, mais on
ignore par quel bout prendre le problème. Au fait, il commence où,
le problème?
Et puis il y a des gens qui sont payés pour ça, non? Laissons-les
faire leur job et contentons-nous de changer le Venmar ou de rénover
le chalet. Les autres s'arrangeront. Moi, de toute manière, j'ai
une ronde de golf à 11 heures. |
Pour apaiser notre conscience (à supposer qu'elle se manifeste),
on s'empressera de laisser tomber quelques pièces dans la tasse
en fer-blanc qu'un bénévole nous tendra au centre commercial.
Les dames patronnesses, version fin de siècle, sont facilement reconnaissables
le samedi avant-midi, enracinées au comptoir des parfums du Eaton
le plus près de chez vous.
Pas à dire, c'est triste.
Deux types de misère
Mettons tout de suite quelques points sur les « i ».
Il y a dans mon esprit deux types de misère: l'inévitable
et la détestable. Que tous les moyens soient mis en oeuvre pour
donner un coup de pouce à ceux qui n'ont vraiment pas de chance,
bien sûr que j'en suis. Mais le grand niaiseux de 35 ans – le genre
deux-bras-deux-jambes pétant de santé – qui tète à
la fois la pension de sa vieille mère et le chèque de b.s.
de sa blonde, alors là, non.
La vraie solidarité avec les pauvres et les mal pris n'a rien à
voir avec les Parlements de la rue et autres babioles issues du puissant
lobby de l'aide sociale. Pour donner un coup de main qui soit digne de
ce nom, ça prend de la poigne. Les Anglos ont une belle expression
qui résume parfaitement l'idée: ils appellent ça «
tough love ».
De la même façon que des parents qui aiment leurs enfants
doivent quelquefois les corriger pour leur apprendre à vivre, il
faut être durs et exigeants avec ceux qui pourraient travailler mais
qui préfèrent se laisser doucement vivre par les prestations
de l’État. Assez durs, à tout le moins, pour leur faire passer
le goût de la farniente subventionnée.
Tous ceux qui sont aptes à prendre soin d’eux-mêmes doivent
le faire, and that's it. Ce n’est que de cette manière que
la société s'évite de tomber dans l'engrenage fatal,
celui qui mène à payer trop cher pour garder trop de monde
en dehors du marché du travail. Plus il y a de travailleurs, plus
il y a de revenus pour l’État, et moins il y a de dépenses
– directes et indirectes, ces dernières étant les plus vicieuses
parce qu'elles savent si bien se camoufler.
Il faut comprendre et aider, je veux bien. Mais arrive toujours un moment
où c’est le grand coup de pied au cul qui force les sans-emploi
et autres éclopés du système à s’aider eux-mêmes.
Plus on les entretient dans l’idée que l’État, quoi qu’ils
fassent, prendra soin d’eux, moins on les incite à se débrouiller
seuls et à devenir responsables.
On crée alors de toutes pièces une armée d'handicapés
sociaux; des gens qui, autrement, auraient pris les moyens pour se sortir
du trou. On ne se développe un caractère que lorsqu'on en
a besoin. À trop se faire gâter, on ramollit. Un grand sage
disait qu'il ne faut jamais donner un poisson à celui qui a faim,
mais lui apprendre à pêcher.
Attendre le prochain chèque
L’irresponsabilité et le pantouflardisme, ça ne fait pas
trop de mal dans la jeune vingtaine; il y a encore un espoir de les réchapper.
Mais à mesure qu’on vieillit, on prend des mauvaises habitudes qui
deviennent carrément impossibles à changer. Une habitude,
après quelques années, devient parfaitement «
naturelle », c'est bien connu.
C'est le premier effort qui est toujours le plus difficile. Après,
on dirait que tout s'enchaîne plus facilement. C'est la même
chose que se lever après une séance de trois heures en La-Z-Boy;
d'abord le choc, ensuite le besoin de marcher un peu pour dégourdir
la machine. À l'inverse, rester assis sur son steak en se répétant
qu'on vit dans un monde qui ne veut pas de nous ne demande pas beaucoup
d'énergie.
Ce n'est pas seulement néfaste parce que ça coûte un
bras à ceux qui se crèvent le coeur à payer leurs
impôts. Entretenir des gens à ne rien faire crée chaque
jour des catastrophes individuelles qui n'ont pas de prix; des citoyens
qui se découragent et se traînent d'une chaise à l'autre
en attendant le prochain chèque au lieu de mettre en oeuvre leurs
capacités et talents en faisant quelque chose de bien de leurs dix
doigts. Une véritable tragédie.
Pousser dans le dos, forcer la personne à se retrousser les manches
et à foncer tête baissée, c'est le meilleur service
à lui rendre. Parce qu'une fois qu'on sait se débrouiller
seul, on se souvient comment faire et on se promet bien de ne plus s'y
faire reprendre. C'est un enseignement pour la vie et, pour dire comme
l'autre: ça déniaise.
À se demander ce qu'on attend.
|