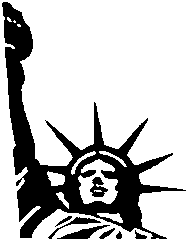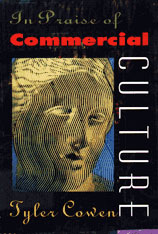| Montréal,
le 1er août 1998 |
Numéro
17
|
 (page 8)
(page 8)
 page précédente
page précédente
Vos
commentaires
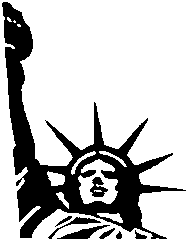
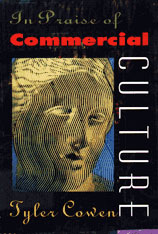 Tyler
Cowen, In Praise of Commercial Culture, Harvard University Press,
Campbridge (Mass.), 1998, 278 p.
Tyler
Cowen, In Praise of Commercial Culture, Harvard University Press,
Campbridge (Mass.), 1998, 278 p.
|
|
|
LIVRE
UNE
VISION OPTIMISTE
DE L'ART
par Gilles Guénette
Si la culture n'est pas qu'un produit de consommation, comme l'affirment
plusieurs, les artistes eux ne sont pas des êtres déconnectés
de la réalité du marché. À preuve, le conflit
qui oppose les musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal
à sa direction. Au coeur du litige, on retrouve une demande de «
salaires comparables à ceux des musiciens des autres grands
orchestres internationaux »(1).
La direction de l'OSM propose une augmentation de salaire de 3% pour les
trois prochaines années, son association de musiciens en réclame
une de 38.5% pour la même période. Certains diront que ces
musiciens ont de la chance d'être payés pour faire ce qu'ils
aiment, mais au-delà de la chance, ces derniers veulent être
reconnus à leur juste valeur – c'est-à-dire, celle du marché.
Et pour les musiciens qui seraient tentés d'éprouver des
remords face à ces revendications, rassurez-vous! Vous ne serez
pas les premiers à vous laisser aller aussi bassement à vos
instincts mercantiles! Bach, Beethoven, Telemann, Mozart et Haendel, pour
ne nommer que ceux-là, étaient tous d'affreux capitalistes.
Ils ne composaient pas que pour leur bon plaisir ou dans un espoir caché
de passer à l'Histoire, ils composaient aussi... pour de l'argent.
Et oui! ces grands de la musique classique n'ont pas simplement fait fortune
en présentant des concerts, en exécutant des commandes ou
en faisant preuve de génie. La plupart d'entre eux publiaient des
partitions musicales afin que des musiciens amateurs puissent jouer leurs
pièces à la maison – pièces développées
à partir de thèmes faciles à comprendre et à
jouer, tout en gardant cette clientèle d'amateurs en tête
lors de l'écriture. |
Ces faits sont tirés du fascinant ouvrage In Praise of Commercial
Culture(2) qui traite de
la relation entre l'artiste et son client et du lien indissociable entre
l'épanouissement de l'art et le marché. Dans un style accessible
et à l'aide de nombreux exemples bien documentés, Tyler Cowen
y présente les principaux facteurs qui ont fait que l'art s'est
développé, et continue de se développer, dans un environnement
où le marché le favorisait. Professeur à l'Université
George Mason à Fairfax en Virginie, Cowen utilise le terme «
art » pour définir tout objet ou performance réalisés
par l'homme qui transporte le spectateur et l'amène à élargir
sa perception du monde ainsi que sa place dans celui-ci.
Tout au long de ces quelque 200 pages, il porte une attention particulière
aux arts visuels, à la littérature et à la musique,
et défend une approche libertarienne de la culture. Car à
l'encontre des Louise Beaudoin et Sheila Copps de ce monde qui mettent
de l'avant une vision hautement pessimiste d'une culture menacée
de tous bords, tous côtés – et que l'on doit donc subventionner
et protéger pour la garder en vie –, Cowen propose une vision optimiste
d'une culture qui se développe de concert avec l'économie
de marché. Pour illustrer son propos, il nous guide à travers
près de 600 années d'évolution culturelle, de la Renaissance
au groupe de musique grunge Nirvana. Et les deux principaux facteurs
qui, selon lui, vont amener l'art à se développer sont la
chute des prix et l'entrée en scène d'une classe de gens
plus aisés.
À l'origine, il y a la pierre
Le matériau étant la base de toute oeuvre d'art, plus son
coût est minime, plus il est accessible à un grand nombre.
Et plus il est accessible, plus les points de vue artistiques se multiplient.
Que ce soit dans le domaine de la peinture, de la sculpture, de la musique
ou de la littérature, la chute des prix des matériaux de
base (la pierre, le bois, le papier...) a permis à l'artiste d'explorer
de nouvelles avenues et de ne plus avoir à s'en tenir à des
« valeurs sûres ». Elle a permis
une multiplication des genres.
À son tour, cette multiplication, jumelée à l'arrivée
d'une classe de gens aisés qui ont les moyens et des raisons d'acheter
des objets d'art (meubler leur maison, offrir des cadeaux, installer une
notoriété familiale, etc.), a favorisé la naissance
d'un plus grand bassin d'acheteurs potentiels. Dorénavant, l'artiste
ne se limite plus aux exigences de clients issus de l'aristocratie – il
ne se limite plus simplement à la demande: il crée l'offre.
L'artiste s'installe là où cette classe aisée est
établie, c'est-à-dire dans les grands centres urbains. L'art
fleurit dans ces grands centres en raison de la présence de cette
classe aisée, mais aussi en raison de la facilité qu'ont
les artistes d'entretenir des contacts et de s'approvisionner en matériaux.
Florence, Amsterdam, Paris et New-York sont des villes qui ont joué
– et qui joue encore dans certains cas – un rôle crucial dans le
développement de l'art. Ces villes ont vu naître ou ont attiré
des créateurs comme Michelangelo, da Vinci, Botticelli, Rembrandt
Vermeer, Hals, Monet, Cézanne, Renoir, etc. Autant d'artistes qui
n'auraient certainement pas connu autant de succès s'ils n'avaient
pas vécu dans ces grands centres où l'économie se
portait bien et le commerce était prospère. Car aussitôt
que l'économie se détériore dans un de ces grands
centres, les artistes le quittent vers des ailleurs meilleurs. Ainsi, l'Italie
laisse sa place aux Pays-Bays après la Renaissance; les Pays-Bays
laissent leur place à la France après leur siècle
d'or; la France laisse sa place à New-York après sa période
des Salons; et New-York...
Aujourd'hui, on peut affirmer sans se tromper que l'art se porte bien.
En fait, il ne s'est jamais aussi bien porté. L'ouverture des marchés,
le rôle grandissant de la femme artiste et les nouvelles technologies
sont autant de facteurs qui favorisent une plus grande accessibilité
à l'art. Résultat: New-York a perdu son titre de capitale
mondiale de l'art au détriment d'un marché de niches éparpillées
à l'échelle de la planète.
Londres, Cologne et Los Angeles par exemple, se sont taillé une
importante place dans le marché de l'art et ont contribué
à faire évoluer notre définition du centre mondial
de l'art. Dans cette vague de décentralisation, certains artistes,
comme Agnes Martin et Georgia O'Keefe, ont même été
jusqu'à s'isoler dans le sud-ouest américain pour peindre
– quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, aurait été
qualifié de suicidaire pour une carrière – le tout, sans
trop de répercussions.
À l'heure du numérique et d'internet
La chute des coûts de reproduction et les nouvelles technologies
de l'information ont permis une dynamisation et une plus grande accessibilité
de l'art. Pour environ 15 $, on peut maintenant s'offrir le
dernier disque compact de Philip Glass, la vidéocassette du dernier
film de Peter Greenaway, la dernière édition d'un des grands
classiques de la littérature française, la visite d'une exposition
regroupant les trésors de l'Egypte ancienne, etc. La chute des coûts
permet à des petits groupes de musiciens « de
garage » d'enregistrer un album, d'en imprimer quelques
centaines de copies et de les distribuer, de façon artisanale, sur
de petits territoires. Cette même chute des prix permet à
de jeunes vidéastes de tourner un premier film sans avoir à
s'endetter pour le reste de leur carrière.
Internet nous permet d'écouter et de visionner ces mêmes produits.
Il nous donne aussi la possibilité d'écouter des musiques
de partout dans le monde, des entrevues auxquelles nous n'aurions jamais
pu avoir accès auparavant, de visionner des émissions de
télévision, des longs métrages, d'avoir accès
à des informations sur les artistes qui les réalisent, de
pouvoir communiquer avec eux, d'exposer ses propres objets d'art... Bref,
internet nous offre une fenêtre sur le monde et sur l'art et cela,
à un coût plus que minime.
In Praise of Commercial Culture est une bouffée d'air frais
pour quiconque s'intéresse de près ou de loin à la
culture. Malgré un chapitre un peu long sur l'évolution de
l'industrie du disque et une conclusion qui nous laisse un peu sur notre
faim, Cowen nous livre une vision très optimiste de ce que pourrait
être un sain marché de l'art si seulement on lui laissait
un peu plus d'espace pour respirer.
Le lecteur québécois y trouvera de quoi remettre en perspective
toute la propagande interventionniste des ministres Beaudoin et Copps.
Il y trouvera des munitions pour défendre les mérites d'une
culture plus ouverte sur le monde et moins protégée artificiellement
par une série de lois, de règlements, de quotas, de clauses
spéciales et de minimums requis. La multitude d'intervenants et
de lobbyistes du milieu culturel québécois et canadien qui
gravitent autour du pouvoir et qui se la coulent douce entre deux ou trois
programmes gouvernementaux y trouveront de quoi rager et augmenter leur
crainte face à ce qu'ils entrevoient comme une « montée
de la droite » – et surtout une menace pour leur job.
Les créateurs y trouveront un art qui repose beaucoup plus sur leurs
créations que sur des critères d'admissibilité ou
des tournures de phrases aguichantes dans d'interminables formulaires pour
obtenir leur subvention.
| 1. Gérin, Marie-Ève,
« OSM: les musiciens sont prêts à annuler
des concerts », La
Presse, jeudi le 9 juillet 1998, p. D8 >> |
| 2. Cowen, Tyler, In Praise
of Commercial Culture, Harvard University Press, Cambridge, Mass.,
London, 1998, 278 p. Pour
ceux qui souhaitent se procurer ce livre via internet, Laissez
Faire Books tient le plus large inventaire de livres libertariens
en Amérique du Nord >> |
|