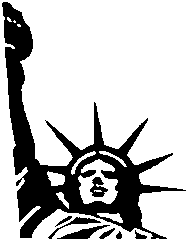Du point de vue de l'École autrichienne (l'une des deux écoles de pensée libertarienne, avec la néo-classique) les crises économiques sont des réajustements nécessaires de la production à la suite d'un trop grand nombre d'investissements improductifs survenus dans une période de boom financier.
On pourrait comparer la situation à celle d'une personne ayant accès
à du crédit facile, qui s'est beaucoup endettée pour
dépenser sur toutes sortes de projets plus ou moins risqués,
et qui frappe un jour un mur parce qu'elle subit trop de pertes. Elle doit
faire des remboursements et doit retirer ses billes des projets les moins
profitables pour concentrer ses ressources diminuées sur les projets
les plus sûrs. La Si on regarde la situation d'un point de vue plus global, dans toute économie, la quantité de capital disponible pour les investissements n'est pas illimitée: elle dépend du taux d'épargne d'une population et de la capacité des entreprises à emprunter à l'étranger si l'épargne locale est insuffisante, de façon à financer des projets aux rendements appréhendés suffisamment élevés pour justifier les taux d'intérêts demandés. La logique économique veut que les projets les mieux ficelés, ceux qui tiennent compte de façon réaliste de l'évolution du marché dans le secteur visé, ceux qui présentent des potentiels relativement forts de profit élevé (l'incertitude étant bien sûr toujours présente), trouveront plus facilement des investisseurs prêts à ouvrir leurs goussets; par contre, les projets plus obscurs, ceux proposés par des amateurs qui ne connaissent pas grand-chose du secteur en question, ceux qui misent plus sur la spéculation risquée à court terme, trouveront plus difficile de se financer. On a tendance à penser que c'est une chose positive lorsque le crédit est facile à obtenir et lorsque le capital d'investissement coule à flot. Mais si, pour une raison quelconque, le crédit est excessivement facile à obtenir, ce ne sont plus uniquement les projets les plus prometteurs qui seront financés, mais aussi de plus en plus de projets plus risqués, avec moins de potentiels de rendement, des projets mal ficelés concoctés par des amateurs ou des crapules, des projets carrément bidon. L'argent investi dans ces projets ne tombe pas du ciel: ce sont des ressources qui auraient pu être dépensées à meilleur escient sur des biens de consommation ou investies ailleurs, dans des marchés plus sûrs. Des ressources qui auraient augmenté le bien-être et le niveau de vie des contribuables de façon immédiate ou à plus long terme, au lieu d'être simplement gaspillées dans des projets non profitables. Le syndrome du stade des Expos C'est justement cette situation qui avait cours en Asie avant le début de la crise. Les pays touchés (Thaïlande, Corée du Sud, Indonésie, Japon, etc.) connaissent des situations très différentes, mais ils ont tous ceci en commun: on y a indûment encouragé le crédit et les investissements depuis des années, par toutes sortes de politiques. Dans certains pays, les banques centrales gardaient les taux d'intérêt artificiellement bas; dans d'autres, la réglementation empêche les compagnies de réduire leurs effectifs ou de faire faillite (et donc de liquider les investissements non productifs); ailleurs, les gouvernements détournent des fonds vers des projets grandioses ou des secteurs monopolistiques contrôlés par la famille et les amis du régime – c'est ce genre de crony capitalism qui régnait en Indonésie sous Suharto; presque partout, l'État intervient massivement avec des subventions et des programmes de tout genre pour favoriser les investissements, comme le font ici la Société générale de financement (SGF), Investissement Québec, et toute la panoplie de saupoudreurs de fonds publics. Ajoutons à cela le crédit facile et généreux offert par des grandes banques occidentales peu soucieuses du risque, parce qu'elle savent que chaque fois que les choses tournent mal – comme au Mexique il y a quatre ans – leurs gouvernements et le FMI viendront inévitablement à leur rescousse pour les sortir du trou. Une pratique bien sûr tout à fait contraire à la logique du capitalisme libéral, qui veut que ceux qui prennent les risques doivent subir les pertes de la même façon qu'ils jouissent des gains, sans soutien de l'État.
Dans ces pays asiatiques qui ont vu leur économie s'effondrer, on
avait englouti des fonds dans ce qui équivaut à des centaines
de stades des Expos – un stade dont on sait très bien qu'il n'attirera
jamais assez de spectateurs pour assurer sa rentabilité s'il est
construit. Des projets trop risqués, qui ne s'appuyaient sur aucune
évaluation crédible du marché dans l'avenir. Des projets
qui, de toute évidence, n'auraient jamais vu le jour sans l'aide
de l'État, ni sans le financement privé rendu artificiellement
accessible à cause, encore une fois, de distorsions dans le marché
financier provoquées par des actions de l'État. Selon le
Wall Street Journal, en 1996, la quantité de prêts
échus en Corée du Sud étaient trois fois plus élevée
que ce qu'on retrouve habituellement dans les pays occidentaux. La compétition
entre les institutions financières pour prêter de l'argent
était tellement féroce que les marges de profit sur les prêts
dépassaient les coûts de financement par seulement 0.2%, dix
fois moins qu'en 1993. Traverser la crise Il n'y a pas 56 façons de se réajuster lorsque la confiance s'effondre et que tout le monde se rend compte que le boom ne peut plus continuer: on retire ses billes de ses positions les plus à découvert, les plus risquées, et on va vers les valeurs sûres. C'est ce qui fait que des milliards de dollars quittent l'Asie et d'autres pays à risque – dont le Canada – depuis des mois pour trouver refuge aux États-Unis. La crise est inévitable: les projets improductifs doivent tout simplement être abandonnés, liquidés, parce qu'ils font disparaître de la richesse au lieu d'en créer. Les maintenir artificiellement en activité par l'injection de fonds supplémentaires, c'est comme jeter des morceaux de bois dans le feu pour éteindre un incendie: on ne réussit qu'à le prolonger, et on gaspille encore plus son stock de bois. La seule chose à faire, c'est de laisser l'incendie s'éteindre de lui-même et reconstruire sur de nouvelles bases. Les capitaux reviendront rapidement d'eux-mêmes lorsqu'il y aura de nouveau une logique économique solide pour attirer les investisseurs.
Continuer à jeter du bois sur le feu est pourtant ce que le FMI,
les gouvernements occidentaux et la plupart des commentateurs économiques
proposent de faire pour solutionner la crise. On a vu les milliards engloutis
jusqu'ici, d'autres suivront. Les États-Unis continuent de faire
pression sur le gouvernement japonais pour qu'il mette en place un autre
Pour contrer ce mouvement, plusieurs solutions à court terme ont été mises de l'avant qui devront recueillir rapidement l'adhésion des pays industrialisés: baisse des taux d'intérêt, stimulation des investissements et de la consommation intérieure des pays et soutien financier mondial à ceux d'entre eux qui font l'objet d'attaques spéculatives injustifiées. (6 octobre 1998)Répétons-le: c'est un excès de crédit facile qui est à l'origine de la crise, pas un manque de liquidités. Mais ce sont les dogmes keynésiens qui dominent depuis des décennies la pensée économique, et ces dogmes veulent que l'État ait toujours la possibilité de relancer la croissance en La crise se répand Ce que tout le monde craint maintenant, c'est que la bulle finisse par éclater aux États-Unis, qui ont eux aussi connu une croissance excessive du crédit ces dernières années avec en prime les mauvais investissements qui accompagnent nécessairement le phénomène. Il suffit de voir comment la Fed, la banque centrale américaine, a concocté il y a deux semaines le sauvetage de Long-Term Capital Management, un très important fonds d'investissement à Wall Street. On craignait, dit-on, que son effondrement ne provoque chez les investisseurs un retrait en cascade de placements risqués et une contraction soudaine du crédit disponible. Quelques jours plus tard, Allan Greenspan annonçait une baisse des taux d'intérêt d'un demi de 1%. C'est mauvais signe.
Pire encore, Bill Clinton proposait cette semaine de mettre en place un
(L'exemple à suivre, et dont on ne parle jamais, c'est plutôt
la crise économique aussi sévère qui est survenue
une décennie plus tôt. De mai 1920 à août 1921,
le chômage est passé de 1.3% à 11.2%, et les prix se
sont effondrés. Mais le gouvernement américain n'a simplement
rien fait – on croyait encore, à l'époque, aux vertus du
laisser faire – et la production et l'emploi se sont rapidement redressés.
Au printemps de 1923, le chômage était redescendu à
1.7% et la production avait rejoint son niveau d'avant la crise. Voir
Bref, ces gens n'ont rien appris. Ce que l'histoire du 20e siècle
nous a montré, c'est que les économies planifiées
finissent par faire faillite, alors que les économies (plus) libres
dominent le monde; que le socialisme crée la pauvreté, alors
que le libéralisme économique crée la richesse. Mais
aujourd'hui, à la veille peut-être d'une nouvelle dépression
économique importante, la seule solution qui fait consensus chez
ceux qui nous ont amené au bord de ce gouffre est la solution interventionniste,
la solution du crédit facile, du garrochage d'argent – notre argent
– sur le problème. La folie socialiste étendue à l'échelle
planétaire, grâce aux bons soins des gouvernements occidentaux,
du FMI (dirigé par un socialiste français, Michel Camdessus)
et avec la complicité des banquiers et des gros investisseurs prêts
à sacrifier leurs idéaux libéraux pour une garantie
de sauvetage par l'État. Espérons seulement que les générations
futures apprendront mieux des erreurs qu'on s'apprête à commettre.
|