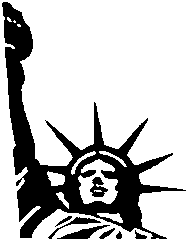| Montréal,
le 7 novembre 1998 |
Numéro
24
|
 (page 2)
(page 2)
 page précédente
page précédente
Vos
réactions
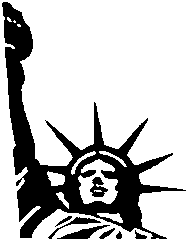
Le
QUÉBÉCOIS LIBRE est publié sur la Toile depuis le
21 février 1998.
Il défend
la liberté individuelle, l'économie de marché et la
coopération volontaire comme fondement des relations sociales.
Il s'oppose
à l'interventionnisme étatique et aux idéologies collectivistes,
de gauche comme de droite, qui visent à enrégimenter les
individus.
Les articles publiés
partagent cette philosophie générale mais les opinions spécifiques
qui y sont exprimées n'engagent que leurs auteurs.
|
|
ÉDITORIAL
LES ABONNÉS DE L'ÉTAT
par Martin Masse
« Mais qui sont les abonnés
de l’État dont parle M. Charest?
Nous nous sentons tous un peu
visés, nous sommes tous
un peu abonnés à
l’État. »
Lucien Bouchard
C'est par ce commentaire stupéfiant de candeur que Lucien Bouchard
réagissait, la semaine dernière, à une déclaration
du chef libéral, qui disait que les politiques proposées
par son parti allaient déranger ces « abonnés
de l'État qui pendant des années ont multiplié les
structures et qui croient qu'il faut davantage d'intervention de l'État
». Le premier ministre poursuivait son interrogation en nommant
quelques-uns des bénéficiaires de l'action gouvernementale:
« Les étudiants qui ont des prêts et bourses?
Les mères qui reçoivent des allocations familiales? Les familles
qui profitent des garderies à 5$? Les démunis qui touchent
des prestations d'aide sociale? » Il aurait bien sûr
pu continuer pendant plusieurs minutes, de quoi remplir au moins le reste
de cette page.
Bien peu de citoyens peuvent en effet affirmer, aujourd'hui, qu'ils ne
sont pas « abonnés » à l'État
d'une façon ou d'une autre. Allocations, subventions, déductions
fiscales, prêts sans intérêt, services étatisés,
programmes de ci ou de ça, plans d'aide, investissement dans la
R&D ou le développement régional, quotas, accès
privilégiés à des emplois: les moyens utilisés
par les gouvernements pour intervenir dans tous les secteurs de l'économie
et de la vie des citoyens n'arrêtent pas de se multiplier. Il suffit
de passer en revue tous les Prix béquille décernés
par le QL depuis huit mois pour s'en convaincre.
Lucien Bouchard a peut-être fait ce commentaire sans trop y réfléchir;
mais, consciemment ou non, il a mis le doigt sur le facteur principal qui
fera qu'il sera probablement toujours chef de gouvernement le soir du 30
novembre. |
Un point de non-retour
Les politiques interventionnistes pratiquées par tous les gouvernements
de la province depuis la Révolution tranquille nous ont en effet
amené à un point proche du non-retour, un point où
il devient extrêmement difficile de convaincre une majorité
de voter pour renverser la situation. Il y a quelques décennies,
l'action des gouvernements visait surtout les plus démunis. Avec
le développement de l'État-providence, ce sont les classes
moyennes qui ont surtout profité des nouveaux programmes mis en
place. Aujourd'hui, même le milieu des affaires, traditionnellement
plus sceptique devant les vertus de l'interventionnisme, ne fait plus rien
d'autre que pleurnicher et manger dans la main des ministres et des dirigeants
des multiples sociétés qui distribuent les fonds publics.
Avec un peu de logique, chacun peut évidemment comprendre que l'argent
distribué par le gouvernement ne tombe pas du ciel, qu'il provient
des taxes payées par les mêmes citoyens. Mais la logique n'a
justement plus grand-chose à y voir. Il y a d'abord un effet de
corruption morale: les citoyens perdent le sens des responsabilités,
finissent pas se complaire dans cette situation de dépendance où
des gens haut placés leur disent qu'ils vont s'occuper de leurs
besoins, surtout lorsque le discours dominant justifie tout cela avec de
beaux mots comme « compassion », «
solidarité », « progrès social
», etc. Mais même pour ceux qui seraient d'accord en
théorie avec la nécessité de sortir de ce cercle vicieux,
le passage du discours à la pratique n'est pas évident. La
justification est toujours la même: aussi longtemps que le système
fonctionne de cette façon – et l'action d'une personne ou d'un petit
groupe n'y changera rien – pourquoi ne pas jouer le jeu? Pourquoi faire
des sacrifices, me priver de quelque chose de disponible, alors que je
vais continuer à payer de toute façon pour que le voisin
en profite? C'est ce que répètent par exemple les gens d'affaires
qui préféreraient que toutes les subventions disparaissent,
mais qui ne peuvent se permettre de laisser leurs concurrents en profiter
à leurs dépens aussi longtemps qu'ils y en a.
Les pratiques interventionnistes – ou « le modèle
québécois », pour employer le vocabulaire
démagogique de Lucien Bouchard – ont donc permis de créer
toute une catégorie de citoyens qui ont intérêt à
ce que cette situation se poursuivent. Il y a d'abord toute la classe des
assistés sociaux, bénéficiaires de divers programmes
et employés de l'État, dont le revenu provient directement
des deniers publics. Comme le dit le premier ministre, ces gens se sentiront
toujours directement visés par toute tentative de réduire
les avantages de leur « abonnement » et auront
fortement tendance à appuyer les partisans de la « compassion
» et de la « solidarité »
puisque l'épaisseur de leur portefeuille en dépend. Ce groupe
constitue maintenant au moins un tiers de la population totale.
Lorsqu'on ajoute les contribuables qui ont l'impression de recevoir plus
en service qu'ils ne donnent en impôts et tous ceux dont l'activité
dépend directement d'un bienfait étatique quelconque – un
parent à faible revenu qui bénéficie des garderies
à 5$, par exemple, ou un entrepreneur subventionné – on dépasse
vite la proportion de 50%. On peut même ajouter à ce groupe
ceux qui ont l'impression de se faire avoir et de toujours payer plus pour
obtenir moins de services, mais qui ont gobé le discours dominant
et qui croient que c'est effectivement en intervenant plus que le gouvernement
réussira à « créer » plus
d'emploi et de richesse. Un gouvernement interventionniste qui veut se
maintenir au pouvoir n'a plus qu'à continuer à entretenir
cette majorité de la population et à la garder satisfaite
– ou à l'épouvanter suffisamment avec les sombres desseins
des « néolibéraux » qui voudraient
revenir au « capitalisme sauvage ».
Pire encore, il est peut-être déjà trop tard pour renverser
le mouvement vers toujours plus d'étatisme, du moins à court
et à moyen termes.
La modération n'a pas meilleur goût
Dans ce contexte en effet, un parti libéral qui propose de réduire
le rôle de l'État n'a presque plus de chance d'être
élu. On le voit bien depuis le début de la campagne au Québec:
chaque fois que Jean Charest s'est risqué à remettre en question
un « acquis », les parasites concernés
ont jeté les hauts cris et les péquistes en ont profité
pour faire valoir qu'ils seraient plus généreux. Le chef
libéral a déjà changé le ton de son discours,
en mettant plus d'accent sur la question référendaire et
sur des solutions plus positives – c'est-à-dire interventionnistes
– pour régler les problèmes dans la santé, l'éducation
ou le travail autonome. Mais en bout de ligne, même en modérant
son discours – déjà excessivement modéré d'un
point de vue libertarien – Jean Charest ne s'assure pas nécessairement
d'appuis supplémentaires. Il concède d'une certaine façon
que c'est l'approche interventionniste qui est la meilleure et à
ce jeu, les péquistes auront toujours l'avantage. En se battant
sur le terrain de l'adversaire plutôt que sur le sien, un politicien
libéral donne tout simplement l'impression d'avoir moins de compassion,
moins de solidarité, moins de générosité. Il
ne convainc personne des avantages du libéralisme, mais il n'arrive
pas non plus à dissiper la peur ou la suspicion des abonnés
de l'État.
Un Parti libéral qui a fait les plus gros déficits de l'histoire
du Québec, qui a abandonné il y a longtemps les principes
libéraux les plus élémentaires, qui prône simplement
un interventionnisme un peu plus modéré que celui du PQ,
qui a contribué pendant des années à augmenter le
nombre des dépendants de l'État, n'a tout simplement plus
en sa possession les armes idéologiques pour abattre le monstre
qu'il a aidé à créer. À plus long terme, il
n'y a pas d'autres façon de réussir qu'en mettant fin aux
compromis et en revenant à des principes fondamentaux.
Maggie Thatcher a, elle, eu le courage de tenter de renverser la vapeur.
Dans une entrevue à l'Observer avant son élection
en 1979, elle disait ce que Jean Charest n'ose pas dire: «
Si quelqu'un vient me voir et me demande: “Qu'allez-vous faire pour
moi?” Je réponds: “La seule chose que je vais faire pour vous, c'est
de vous rendre plus libre de faire des choses pour vous-même. Si
vous ne pouvez pas le faire, alors je suis désolée, je n'ai
rien d'autre à vous offrir.” » Ce serait prendre
un grand risque de dire cela aujourd'hui, et peut-être s'assurer
une défaite encore plus cuisante. Mais le pari pourrait au moins
porter fruit un jour, surtout si les libéraux se mettaient à
vraiment expliquer les avantages de la liberté et des solutions
fondées sur le libre marché, au lieu de toujours céder
aux pressions des groupes d'intérêt quémandeurs. Aussi
longtemps toutefois que personne, dans la sphère politique, ne contestera
systématiquement l'idée que les gouvernements «
créent » des emplois et de la richesse, comment peut-on
espérer qu'une majorité appuiera quelqu'un qui arrive soudainement
sur la scène pour dire le contraire pendant seulement quelques jours
au début d'une campagne électorale?
Seule une véritable révolution intellectuelle mènera
à des changements à long terme. Une contre-culture libertarienne
qui pourra se présenter comme une alternative lors des crises qui
viendront inévitablement, lorsque suffisamment de gens douteront
pour appuyer enfin des changements plus radicaux. On peut toujours rêver
et espérer que Jean Charest choisira d'appuyer une stratégie
semblable après la défaite qui se profile à l'horizon.
Entre-temps, si une renaissance des idées de liberté doit
avoir lieu, c'est uniquement ici, au QL, que se trame la révolution.

Le Québec libre des
nationalo-étatistes
|
« Après avoir pris ainsi
tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu, et l'avoir
pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur
la société tout entière; il en couvre la surface d'un
réseau de petites règles compliquées, minutieuses
et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux
et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient faire jour pour dépasser
la foule; il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les
plie et les dirige; il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse
à ce qu'on agisse; il ne détruit point, il empêche
de naître; il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il
énerve, il éteint, il hébète, et il réduit
enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux
timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger. »
Alexis de Tocqueville
DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE
(1840) |
|