| Montréal,
le 20 février 1999 |
Numéro
31
|
 (page 8)
(page 8) |
 page précédente
page précédente
Vos
commentaires
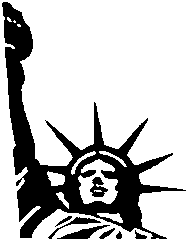
ÉCRIVEZ-NOUS
Vous n'êtes pas d'accord avec le contenu d'un article? Vous avez
une opinion à partager? Vous voulez dénoncer une autre stupidité
proférée par nos élites nationalo-étatistes
ou souligner une avancée de la liberté?
 LE QUÉBÉCOIS LIBRE publiera toutes les lettres pertinentes.
N'oubliez pas d'écrire vos nom et lieu de résidence. We also
accept letters in English.
LE QUÉBÉCOIS LIBRE publiera toutes les lettres pertinentes.
N'oubliez pas d'écrire vos nom et lieu de résidence. We also
accept letters in English.
|
|
|
COLLABORATION
DE LA RESPONSABILITÉ
SOCIALE DE L'ENTREPRISE
par Jean-Luc Migué
De quoi s’agit-il? La première tâche qui s’impose est de définir
de façon analytique le concept de responsabilité sociale.
Or si elle a un sens, cette notion ne peut signifier qu’une chose: Pour
assumer une responsabilité sociale, l’entreprise devrait poursuivre
d’autres finalités que le profit. Elle devrait sacrifier le profit
pour pratiquer l’altruisme corporatif. Voilà la notion clé
de ce mouvement.
Cette précision n’est pas qu’un homme de paille. On peut lire par
exemple dans un petit fascicule de propagande(1)
que la construction d’un bilan social – expression comptable de la notion
de responsabilité sociale – doit faire état d’une variété
illimitée de dimensions, dont un grand nombre ne sont que l’énumération
des conditions à réaliser pour maximiser le profit. Ainsi,
l’entreprise doit soigner ses relations avec ses employés en tenant
compte de leur rémunération et leurs conditions de travail.
L’entreprise doit se soucier de ses clients, de ses fournisseurs, de ses
concurrents, des organismes de réglementation. Personne ne contestera
ces préceptes, mais parler alors de responsabilité sociale,
c’est diluer le concept au point de lui retirer toute signification. L’entreprise
qui omettrait de les suivre serait vouée à l’échec
et à la disparition. L’instinct du profit suffit à lui seul
à la convaincre de suivre cet enseignement.
En réalité, les protagonistes de cette idée ont un
autre agenda en tête. Ce qu’ils proposent, c’est que l’entreprise
sacrifie sa finalité propre qui est de maximiser ses profits, c'est-à-dire
créer de la richesse pour ses actionnaires, au profit de finalités
fumeuses qu’on regroupe le plus souvent sous le vocable suspect de «
relations avec la communauté ». Concrètement,
cette consigne signifie la poursuite d’objectifs aussi insaisissables que
la création d’emplois factices, la sauvegarde de l’environnement,
la pratique de la discrimination à l’envers dans le recrutement
(reverse discrimination), et, bien sur, l’octroi de subventions
généreuses à toutes sortes de causes à la mode,
dont les arts et la culture, l’éducation, les sports, la santé,
le processus démocratique, et j’en passe. |
|
La notion analytique de responsabilité sociale exclut donc cette
forme fréquente de générosité apparente par
laquelle l’entreprise se protège contre la menace d’une réglementation
publique gênante, ou moins souvent contre le boycottage des acheteurs
ou des fournisseurs. Il s’agit le plus souvent de susciter un capital de
sympathie ou de sauvegarder la loyauté des consommateurs. Il faut
alors convenir que l’entreprise ne fait que maximiser ses profits à
long terme. On ne saurait blâmer l’entreprise de se prémunir
par anticipation contre cette forme de coercition. On ne saurait davantage
parler d’altruisme. On se souvient de l’exposé du président
de la Banque de Montréal quelques semaines avant la décision
du ministre des Finances sur la fusion des banques. On aurait cru entendre
un leader activiste, plus qu’un banquier. Au mieux, cette pratique n’est
que tape-à-l’œil et window-dressing; au pire elle s’apparente
à de la fraude.
Intérêt privé déguisé
en souci du bien commun
Il faut aussi rejeter la fausse vertu du donateur corporatif qui invoque
la responsabilité sociale comme instrument déguisé
de protection contre la concurrence de rivaux. Ainsi les plus grandes entreprises
sont souvent les plus ferventes partisanes de la réglementation
rigoureuse de l’environnement. Elles reçoivent souvent dans ce combat
l’appui empressé des grands syndicats qui ne dédaignent pas
non plus de jouer les vertueux de l’écologie. Or il se trouve que
l’appel à la réglementation publique ne fait souvent que
cacher leur ambition de se protéger contre la concurrence de PME
rivales qui devront en assumer des coûts sensiblement plus élevés.
Il appert en effet que de s’astreindre à une réglementation
publique donnée coûte près de 10 fois plus cher à
la PME qu’à la grande entreprise syndiquée. Certaines estimations
américaines fixent à 5-10% l’accroissement des profits et
des salaires syndicaux qui découlent du resserrement de la réglementation
environnementale.
En d’autres termes, la réglementation publique prétendument
désintéressée s’avère n’être qu'une vulgaire
entreprise de cartellisation. L’adhésion empressée et paradoxale
de nombreuses entreprises au protocole de Kyoto ne se comprend souvent
que dans cette perspective. Les vendeurs de gaz naturel ne manqueront pas
de profiter d’une poussée fantastique des ventes de l’épouvantail
du réchauffement de la planète. Les producteurs de systèmes
de contrôle de l’énergie, tel Honeywell, sortiront aussi gagnants
de ce gigantesque alarmisme. Dans le même sens, des grandes entreprises
comme Frito Lay ont tiré grand profit de l’initiative gouvernementale
d’imposer la description superflue du contenu en gras. Sa rivale de moindre
taille et moins bureaucratisée, Gourmet Foods, a même dû
cesser de produire certaines lignes de produits par la faute de cette disposition
frauduleuse.
Pratique moralement condamnable
Dans ses principes essentiels, l'enseignement de l'économique en
matière de responsabilité sociale a été énoncé
il y a 30 ans par Milton Friedman: Il n'y a, enseignait déjà
le Lauréat Nobel, qu'une seule responsabilité sociale pour
l'entreprise, c'est de combiner ses ressources d'une façon qui maximise
ses profits. Dans une société libre et ouverte, seuls les
individus physiques, « réels », peuvent
avoir des responsabilités, non pas des entités abstraites
comme les corporations. Les actionnaires individuels et les managers individuels
peuvent se définir des obligations vis-à-vis leur famille,
vis-à-vis leur Église, vis-à-vis leur club social,
vis-à-vis leur pays. Le contraire constituerait une doctrine subversive.
Le manager qui puise dans les ressources de l’entreprise pour pratiquer
l’altruisme, se trouve à poser un geste propre au processus politique,
c'est-à-dire à pratiquer la charité avec l’argent
des autres, l’argent des actionnaires dont il diminue le rendement, ou
celui des consommateurs pour qui il élève le prix, ou celui
des employés dont il abaisse la rémunération. Inviter
les managers à pratiquer l’altruisme corporatif, c’est donc opter
pour l’atténuation des titres de propriété, pour le
recours à une forme de fiscalité au service de la charité.
C’est prôner un mode d’allocation des ressources par un mécanisme
politique. Dans le langage conventionnel, on désigne ce régime
par le terme de socialisme.
La signification ultime en est que le manager se trouve à utiliser
sa marge discrétionnaire pour poursuivre son propre agenda. Il tire
une certaine gloriole à pratiquer la charité, même
si c’est avec l’argent des autres. Ça lui sert occasionnellement
à camoufler sa rémunération perçue comme exorbitante
par le milieu et surtout par les politiciens qui menacent d’intervenir.
Il en obtient le prestige et l’éminence sociale associés
à la charité publique et aux valeurs à la mode dans
le milieu du big business.
Si les managers de l'entreprise ont une responsabilité sociale,
qui la définira? Comment les businessmen découvriront-ils
ce qu'est l'intérêt social supérieur? À quel
titre les managers sont-ils mandatés pour choisir les finalités
sociales, pour définir le bien commun? Sur quoi vont-ils fonder
leur choix entre l’octroi de fonds à l’université ou à
un groupe écolo ou à quelqu’autre regroupement d’activistes?
Sur quels fondements vont-ils s’appuyer pour fabriquer des emplois dans
une région plutôt que l'autre? En réalité, ils
n’ont aucun titre à l’exercice de cette tâche.
La pratique de la responsabilité sociale donnerait donc lieu à
un paradoxe: La responsabilité sociale implique la substitution
d’une décision managérielle à celle des actionnaires
propriétaires. Comme partout où les droits de propriété
sont atténués, par exemple dans le secteur public, l’irresponsabilité
individuelle s’ensuit. La pratique de la responsabilité sociale
mène à l’irresponsabilité individuelle.
Pratique désastreuse pour l’économie
et la croissance
Au plan économique, la généralisation de cette pratique
mènerait à la fin de la croissance économique à
long terme et rendrait donc impossible la réalisation des finalités
sociales recherchées par les protagonistes de la responsabilité
sociale. Il faut en cette matière revenir à l'enseignement
essentiel de la théorie économique, au marché comme
mécanisme de sanctions et de récompenses, au rôle des
incitations sur les comportements, en un mot à la main invisible.
L'analyse fait la distinction entre les mobiles qui guident les managers,
leur intérêt, et les conséquences de leur comportement
habituel, croissance et hausse du bien-être général.
La théorie et l'histoire démontrent que dans sa recherche
du profit maximum pour ses actionnaires, l'entreprise réalise «
le bien commun » en sous-produit, et surtout,
que l'ambition des « do-gooders » de la
détourner de sa finalité propre qu'est le profit, produit
l'effet exactement contraire à celui qu'on suppose.
Au fond, l’appel à la responsabilité sociale de l’entreprise
implique que le profit est immoral, qu’il est un mal. On sait que le profit
comme mobile est à l’origine de la hausse phénoménale
du revenu des économies industrialisées. Plutôt que
de chercher à épuiser les applications infinies de cette
logique marchande, essayons d'identifier l'impact global de la main invisible
associée à l'entreprise capitaliste. Il existe une mesure
universelle incontestable de ses accomplissements! C'est la hausse inimaginable
du revenu des travailleurs et de leur famille, qui leur a valu l'alimentation
et le logement pour tous, l'ordinateur à un prix dérisoire,
la résonance magnétique et le Saran Wrap.
Or la généralisation de la responsabilité sociale
est l’équivalent d’une taxe supplémentaire sur les profits.
Et suivant la règle universelle, là où les droits
de propriété et la liberté de choisir sont protégés,
les marchés modérément libres et le fardeau réglementaire
et fiscal léger, le taux de croissance est élevé et
l'innovation florissante. Là où, comme au Québec depuis
une génération, le fardeau fiscal et le poids réglementaire
sont grands, le progrès économique ne s'observe pas et l’économie
recule. Appeler à la responsabilité sociale, c’est vouloir
tuer la poule aux œufs d’or.
Objectifs inatteignables
Pire encore, même s’il recherchait le bien commun, le manager n’y
parviendrait jamais. Dans la poursuite de finalités sociales, l’entreprise
altruiste n’atteindra jamais le but recherché. Elle fera plus de
mal que de bien. Par exemple, l’entreprise qui s’abstiendrait de déverser
des déchets légalement permis dans l’environnement ne ferait
que laisser la voie libre à sa voisine pour l’exploiter davantage.
Elle aurait donc assumé des coûts supérieurs sans générer
de bénéfices en contrepartie, soit la définition même
de gaspillage. Le plus souvent, le manager qui pratique l’altruisme avec
l’argent des actionnaires aime à faire valoir les bienfaits de son
geste, mais il se garde bien d’en révéler le coût.
L’employeur qui embauchera des minorités moins productives pour
vernir son image se gardera bien de faire état de la hausse des
coûts de production et de la baisse consécutive de l’emploi
global qui pénalisera d’autres travailleurs. L’employeur qui créera
des emplois factices dans une région se gardera bien de faire état
des pertes d’emplois qu’il occasionnera ailleurs dans d’autres régions.
À la limite, en haussant le coût du travail, il suscitera
la substitution artificielle du capital au travail. La production nationale
et l’emploi en souffriront.
D’où l’appel de plus en plus pressant des bien-pensants en faveur
d’efforts coopératifs pour la poursuite de finalités sociales.
C’est le cas par exemple de l’exercice corporatiste qui s’incarne chez
nous dans les sommets socio-économiques. On aboutit dès lors
directement à la formule de planification centrale sous l’égide
de l’arbitre ultime, l’État. L’allocation des ressources par décision
centrale. Une fois de plus, la formule mène directement au socialisme.
Menace à l’entreprise comme institution
de progrès
N’hésitant à recourir au chantage, les protagonistes de la
responsabilité sociale soutiennent qu’il y va de l’intérêt
de l’entreprise libre de se montrer altruiste. Il n’est pas accidentel
que ces nouveaux apôtres reprennent le refrain que les premiers keynésiens
dégageaient de la doctrine du même nom. La pratique de la
responsabilité sociale, serait, comme le keynésianisme en
son temps, le rempart contre les assauts des adversaires du capitalisme,
contre le collectivisme. Or, cette pratique est l’expression même
du socialisme.
Que la charité corporatiste soit une entreprise de relations publiques
indispensable, une forme de marketing imposé par le contexte moderne
ne repose sur aucune documentation empirique. Il s’agit en fait d’une affirmation
gratuite. Ce qu’on connaît avec assurance, c’est une longue liste
d’initiatives altruistes qui se sont retournées contre l’entreprise
qui les avait prises. Ainsi, un grand détaillant de vêtements
américain (Dayton Hudson) choisissait récemment d’exprimer
sa générosité en faveur de Planned Parenthood.
Immédiatement, les groupes pro-vie entreprennent des manifestations
devant les magasins de l’entreprise. Celle-ci entreprend de colmater la
brèche en offrant aussi ses faveurs aux groupes Right to life.
Qu’à cela ne tienne, ce sont maintenant les pro-choice qui
montent les manifestations. Levi Strauss ouvrait récemment ses goussets
au profit des scouts, pour se voir immédiatement honni par les gais
qui nourrissent des préjugés constants vis-à-vis les
scouts, jugés trop straight. Levi Strauss retire ses faveurs
aux scouts, mais non sans susciter un backlash chez les leaders
religieux qui proposent le boycottage du fabricant. Motorola n’avait pas
aussitôt annoncé des dons à la communauté locale
qu’elle est menée au pilori par les fervents de l’environnement
qui ne voient dans la générosité de Motorola qu’une
manœuvre pour camoufler le mauvais traitement qu’elle fait à l’aquifère
local.
Quand de plus on prend acte de l’identité des défenseurs
de ce fétiche, on discerne mieux le caractère louche de l’entreprise.
Parmi les principaux protagonistes de ce concept, on distingue les politiciens
et les bureaucrates, qui y voient une façon détournée
de transférer la richesse sans assumer l’odieux de prélever
des taxes; on distingue également les activistes de tout acabit
et les intellectuels de la go-gauche, les Galbraith, les Nader, les Yves
Michaud, qui propagent l’idéologie socialiste et associent sans
fondement tous les maux sociaux au capitalisme; on distingue enfin, et
de façon paradoxale, les représentants des grandes entreprises,
qui, cocus contents, ne savent pas reconnaître l’incohérence
de leur position, tout en regardant de haut les petits entrepreneurs qui
volent moins haut qu’eux. Au cœur même de l’empire capitaliste, les
États-Unis, les grandes sociétés se révèlent
trois fois plus généreuses à l’endroit des groupes
idéologiques et politiques anti-marché, pro-gouvernement
et anti-business qu’à l’endroit des groupes conservateurs
et pro-marché.
Pour le plus grand bien de tous, l’ampleur de la menace que constitue le
fétiche courant de la responsabilité sociale n’est pas alarmante.
Le marché impose des limites serrées à ce gaspillage.
Ces heureuses contraintes proviennent de la concurrence que subissent les
entreprises à la fois sur le marché de leurs produits et
sur le marché du capital et des managers. Le budget discrétionnaire
du manager susceptible d’être affecté à l’altruisme
à la mode ne peut dépasser une faible fraction du profit
que dégagent les grandes entreprises. Les actionnaires ont le pouvoir
de limiter l’arbitraire managériel. Ils peuvent bien sûr liquider
les actions qu'ils détiennent dans les entreprises trop prodigues
et surtout ils peuvent compter sur la menace que le marché du capital
laisse constamment planer sur les managers pour le contrôle des grandes
entreprises. En résumé, on peut dire que l’ampleur du gaspillage
ne peut jamais dépasser ce qu’il en coûterait aux opposants
pour monter des proxy fights effectifs, des fusions, des soumissions
ou des prises de contrôle. En un mot, les sommes affectées
à l’altruisme corporatif ne peuvent atteindre au maximum que ce
qu’il en coûterait pour expulser les managers trop libéraux
en place. Ça n’est pas rien, mais ça n’est pas non plus dramatique.
Les estimations courantes en situent l’ampleur à moins de 3% des
profits.
Au mieux, cette option est un cul-de-sac, qui ne mène donc nulle
part. Au pire, elle sonnerait le glas de la croissance économique
et du progrès tout court.
1. P. Béland et J. Piché,
Faites le bilan social de votre entreprise, Montréal,
Les Éditions
Transcontinental, 1998. >>
Articles précédents
de Jean-Luc Migué |
|