| Montréal,
le 4 avril 1999 |
Numéro
34
|
 (page 2)
(page 2) |
 page précédente
page précédente
Vos
réactions
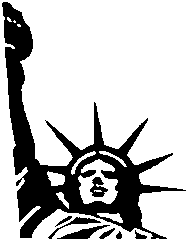
Le QUÉBÉCOIS
LIBRE est publié sur la Toile depuis le 21 février 1998.
Il défend
la liberté individuelle, l'économie de marché et la
coopération volontaire comme fondement des relations sociales.
Il s'oppose
à l'interventionnisme étatique et aux idéologies collectivistes,
de gauche comme de droite, qui visent à enrégimenter les
individus.
Les articles publiés
partagent cette philosophie générale mais les opinions spécifiques
qui y sont exprimées n'engagent que leurs auteurs.
|
|
|
ÉDITORIAL
MONTRÉAL: UNE ÎLE,
UNE MÉGABUREAUCRATIE?
par Martin Masse
La fièvre des fusions s'est emparée de l'esprit de nombreux
Montréalais ces derniers jours. Le débat sur l'avenir de
la région métropolitaine a en effet repris de plus belle
depuis le coulage d'un rapport sur la fiscalité municipale, qui
proposerait de fusionner les 29 municipalités de l'île de
Montréal à l'intérieur de trois grandes villes. La
ville de Montréal, qui comprend un peu plus de la moitié
de la population de l'île, se plaint depuis des années d'être
défavorisée sur le plan fiscal par rapport aux banlieues,
qui n'ont pas à supporter les infrastructures d'une ville centre
tout en profitant de ses avantages.
Le débat dure en fait depuis plus de trente ans et on en revient
toujours au seul modèle alternatif simple et logique lancé
par le maire Jean Drapeau à la fin des années 1960: celui
d'« une île, une ville ». Simple
et logique en surface seulement, car en fait sa mise en oeuvre serait une
catastrophe à tous égards pour la métropole.
Mégalopole = Mégalomane
Ce n'est pas un hasard si ce concept a d'abord surgi dans la tête
d'un maire autoritaire aux idées de grandeur. Une bonne partie de
l'attrait du projet vient en effet du « prestige »
qui jaillirait supposément sur une « mégacité
à dimension internationale », comme nous l'expliquent
les jet-setters potentiels qui en profiteraient. Une telle fusion forcée
a eu lieu récemment à Toronto, où les nouveaux riches
de l'élite locale souffrent d'un complexe d'infériorité
par rapport aux villes plus sophistiquées du continent. Avec la
fusion, ils ont finalement eu leur « world
class city » et cela malgré l'opposition
d'une majorité de leurs concitoyens.
Non seulement les mégalomanes et les jet-setters branchés,
mais aussi tout ce que la région de Montréal compte de nationalo-gauchistes
voit d'un bon oeil une telle fusion. Le fait que les banlieues en général,
et celle du West Island en particulier, soient beaucoup plus riches que
les vieux quartiers de la ville centre en énerve plusieurs. Avec
une seule ville, il serait tellement plus facile « d'étaler
le fardeau fiscal », c'est-à-dire de siphonner
la richesse des quartiers riches pour entretenir les autres. |
|
Ce n'est pas pour rien si l'un des défenseurs du projet de ville
unique, un politologue du nom de Michel Magnant qui a signé une
série d'articles dans La Presse, dénonçait
la recommandation du rapport sur la fiscalité comme favorisant le
West Island. Comparant les richesses foncières des villes de l'ouest,
du centre et de l'est qui surgiraient de ce modèle, il déplore
que « la ville de l'ouest serait trois fois plus riche
que sa consoeur de l'est, près de 65% plus peuplée et 50%
plus riche per capita. Deux extrêmes urbains, deux extrêmes
de richesse. »
Mon Dieu, quelle horreur!, il y a des quartiers riches et d'autres pauvres
à Montréal! On se demande pourquoi ce socialiste ne recommande
pas un dispersement forcé de la population riche sur le territoire
en plus d'une fusion forcée, question de vraiment s'attaquer au
coeur du problème.
Un autre argument qui n'est pas évoqué publiquement mais
qui entre sûrement dans les calculs du gouvernement péquiste
est celui de la présence anglophone. L'une des réglementations
les plus idiotes de la loi 101 au Québec prescrit que
seules les municipalités comptant plus de 50% d'anglophones ont
le droit d'offrir des services en anglais et d'ériger des affiches
et panneaux dans les deux langues. La proportion d'anglophones dépasse
50% dans plusieurs des petites municipalités existantes du West
Island, mais serait réduite de façon drastique dans une ville
amalgamée. Si on ajoute à cette question de langue celle
de la partition – plusieurs de ces municipalités ayant adopté
des résolutions partitionnistes depuis le dernier référendum
– on constate qu'une fusion aurait l'avantage non négligeable, pour
nos nettoyeurs linguistiques, de submerger une fois pour toutes les anglophones
dans une mer francophone et d'éliminer à toute fin pratique
leur influence politique locale.
Faux arguments
D'autres supporteurs du modèle « une île,
une ville » offrent des arguments qui s'apparentent
plus à la vision libérale classique, mais qui le font de
manière simpliste et erronnée. Par exemple, le chef de l'ADQ
Mario Dumont s'inspire de l'expérience torontoise – initiée
par une de ses idoles, le premier ministre conservateur Mike Harris – pour
prétendre qu'une fusion éliminerait un tas de bureaucraties
coûteuses et rationaliserait la gestion municipale dans la région.
La fusion torontoise est pourtant l'une des manoeuvres politiques les moins
conservatrices et les moins libertariennes que Mike Harris laissera en
héritage. Elle s'apparente bien plus aux instincts autoritaires
d'un petit politicien de province qui ne comprend rien au fonctionnement
d'une grande ville.
Le principe de subsidiarité, que M. Dumont appuie sur le plan de
la structure politique fédérale du Canada, s'applique de
la même façon au niveau des agglomérations urbaines
et des régions. Le Canada serait-il mieux administré, de
façon moins bureaucratique et moins coûteuse, si l'on abolissait
les provinces pour tout centraliser à Ottawa? Évidemment
que non. Les municipalités sont un niveau essentiel de gestion démocratique,
le plus près du citoyen, le plus réceptif à ses besoins
aussi à cause de cette proximité.
En créant une mégaville, on ne réduit pas le poids
de la bureaucratie – on l'augmente! On crée des mégabudgets
impossibles à comprendre pour le citoyen; des mégastructures
labyrinthiques et décrochées de la réalité;
des mégaconseillers municipaux qui ne sont plus redevables à
leurs commettants; des mégaservices lourds et coûteux; et
des mégamafias syndicales violentes et criminelles. Ce n'est pas
un hasard si la Ville de Montréal a les taxes les plus élevées
sur l'île, les services les moins efficaces, ni si deux dirigeants
du syndicat des cols bleus sont en prison pour vandalisme, alors qu'un
autre du syndicat des cols blancs est devant les tribunaux pour avoir tiré
des coups de feu sur le chalet d'un administrateur de la Ville!
Les bienfaits de la concurrence
Si Mario Dumont veut appliquer les principes de libre marché au
débat sur l'avenir de Montréal, il devrait plutôt regarder
du côté de la concurrence. La concurrence force les entreprises
à offrir les meilleurs produits au plus bas prix, sinon le consommateur
va acheter ailleurs; elles force de la même façon les États,
provinces et municipalités à offrir les meilleurs services
au plus bas niveau de taxation, sinon ces gouvernements risquent de perdre
des contribuables au profit des territoires voisins.
Un habitant de la grande région de Montréal peut, s'il est
insatisfait de la qualité de vie dans sa municipalité, déménager
un peu plus loin. Les petites villes n'ont pas le choix d'être sensibles
à cette pression. La Ville de Montréal, elle, est tellement
grosse qu'elle peut se permettre une autre stratégie pour cacher
sa mauvaise gestion, une stratégie typique de parasite: exercer
des pressions sur le gouvernement provincial pour obtenir un «
pacte fiscal » et faire payer les banlieues et
le reste de la province. En créant une mégaville, on tuera
ce qui reste de concurrence entre les municipalités de la région
et on fera de Montréal une gigantesque siphonneuse de fonds pour
alimenter son appétit bureaucratique.
Selon l'éditorialiste de La Presse Agnès Gruda, «
la fusion (...) demeure la seule solution susceptible d'arracher
la région métropolitaine à son marasme. »
Faux! D'abord, la plupart des municipalités de banlieue sont bien
administrées et prospères. C'est la Ville de Montréal
qui est dans le marasme, pas la région. Une façon logique
de la sortir de ce marasme serait de renverser le mouvement historique
d'annexion des villes avoisinantes qui l'a fait grossir jusqu'à
aujourd'hui, et de carrément la casser en quatre ou cinq plus petites
villes. Celles-ci seraient alors forcées d'adopter les standards
plus élevés de leurs voisines pour rester concurrentielles
et cesseraient d'être un poids financier pour toute la région.
C'est d'ailleurs ce que propose le maire de Dollard-des-Ormeaux Ed Jariszewski,
qui demande avec à-propos: « C'est Montréal
le cancer – pourquoi veut-on opérer les municipalités en
santé? »
Enfin, une autre solution toujours à l'ordre du jour, pour quelque
gouvernement de quelque taille que ce soit, est de privatiser des services,
de cesser d'intervenir partout et de réduire la réglementation
excessive et les taxes. Lorsque tout cela aura été fait,
Montréal deviendra alors une véritable « mégacité
», non pas au profit du jet-set, des politiciens et des employés
municipaux, mais à celui de ses citoyens.
Articles précédents
de Martin Masse |

Le Québec libre des
nationalo-étatistes
|
« Après avoir pris ainsi
tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu, et l'avoir
pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur
la société tout entière; il en couvre la surface d'un
réseau de petites règles compliquées, minutieuses
et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux
et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient faire jour pour dépasser
la foule; il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les
plie et les dirige; il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse
à ce qu'on agisse; il ne détruit point, il empêche
de naître; il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il
énerve, il éteint, il hébète, et il réduit
enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux
timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger. »
Alexis de Tocqueville
DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE
(1840) |
|