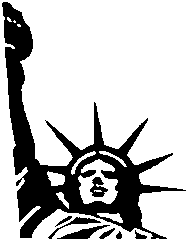| Montréal,
le 14 mars 1998 |
Numéro
2
|
 (page 2)
(page 2)
 page précédente
page précédente
Vos
commentaires
|
ÉDITORIAL
LA
CRISE DE L'ÉTAT ET
L'ÉTAT
DE CRISE PERMANENT
Dans ce pays, l'État a depuis longtemps
cessé de jouer son rôle primordial de protecteur des droits
individuels et de garant de la sécurité de ses citoyens.
L'essentiel de son activité consiste maintenant à tenter
de régler des problèmes sociaux, économiques, culturels
et moraux réels ou imaginaires, et à se donner des objectifs
abstraits comme « l'épanouissement culturel
» de la population.
Le gouvernement fédéral prévoit ainsi dépenser
160 millions de dollars pour fêter l'arrivée du millénaire,
c'est-à-dire une date arbitraire avec trois zéros, alors
même que des centaines de milliers de ses citoyens sont dans le besoin.
Cent soixante millions de dollars, c'est 160 $ pour un million
de gens pour qui il s'agit d'une somme importante.
Lorsqu'un gouvernement peut se laisser aller à des dépenses
et des actions aussi futiles, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi
il cède à toutes les pressions lorsque les enjeux semblent
le moindrement plus importants.
Une démocratie de pleurnichage
De nos jours, ce que nous appelons le processus démocratique n'est
en réalité qu'un forum où chaque lobby organisé
tente d'attirer l'attention sur son pauvre sort et de soutirer une faveur
étatique qui ira dans le sens de ses intérêts. Ceux
qui pleurnichent le plus fort et qui réussissent, soit par une campagne
de marketing habile, soit par des menaces de grève ou autres pressions,
à convaincre l'État du sérieux de leur cas, obtiendront
à coup sûr les bonbons qu'ils demandent.
C'est pour cette raison que nous avons instauré trois Prix Béquille:
pour dégonfler un peu l'importance que les médias accordent
à ce choeur de pleureuses que sont les lobbys. En effet, la lecture
d'un quotidien ou l'écoute d'un journal télévisé
se résume à peu de choses près, jour après
jour, à la même sempiternelle recension des doléances
et revendications des uns et des autres, suivies des négociations
avec le ministre récalcitrant, et enfin de l'annonce triomphale
de la remise du bonbon, ou encore de l'échec des négociations
et de la reprise du processus.
Pas étonnant dans ce contexte que le sentiment que notre société,
notre système politique, notre économie, sont constamment
en crise soit si généralisé. Suivre l'actualité,
c'est suivre pas à pas la crise de l'industrie porcine qui fait
face à une chute des prix, celle des urgences bondées dans
les hôpitaux, celle des pêcheurs au chômage, celle des
acériculteurs sinistrés, celle des travailleurs de l'auto
qui ne veulent pas de compétition, celle des nationalistes dont
« l'âme collective » fout le
camp, etc.
Un monde incohérent et irrationnel
Le monde décrit par les médias est incohérent et irrationnel.
Il est dominé par des affrontements inutiles, entretenus par un
État ouvert à toutes les revendications. S'en isoler est
pour plusieurs un soulagement psychologique. Dans
une société libertarienne, la plupart de ces crises trouveraient
un règlement dans un espace privé, celui du marché.
Pour prendre quelques exemples: |
–les chutes ou hausses de prix touchent à
un moment ou l'autre tous les produits et services. Les producteurs
et consommateurs s'y adaptent dans la plupart des cas et il n'existe aucune
raison logique pour traiter les producteurs de porc de façon spéciale.
–toutes les industries se transforment
et traversent des périodes où l'emploi diminue. La presque
totalité des individus se recyclent et trouvent du travail ailleurs.
Il n'existe aucune raison logique pour traiter des groupes de chômeurs
concentrés géographiquement ou dans un secteur particulier
de façon spéciale.
–toutes les activités
humaines sont sujettes à des catastrophes. La seule solution responsable
est de s'assurer, comme le fait chacun pour ses biens et sa vie. Laisser
l'État devenir l'assureur collectif systématique à
la suite de chaque tragédie, c'est ouvrir la porte à l'irresponsabilité
et à un marchandage constant.
Dans une société libertarienne, l'État ne ferait pas
les trois quarts des choses qu'il fait en ce moment. Il y aurait peu ou
pas de lobby, parce qu'aucun bonbon à distribuer. Le gouvernement
ne serait l'objet d'aucun chantage, d'aucune supplication, puisqu'il se
contenterait d'appliquer des règles similaires pour tous. Il n'y
aurait plus de favoritisme envers ceux qui chialent le plus fort, plus
de négociations à huis clos pour éviter les grèves
et les moyens de pression qui paralysent des villes entières, plus
de psychodrame où l'avenir de la nation est en jeu.
Il n'y aurait plus d'épanchements émotifs ni d'analyses statistiques
interminables sur des aspects abstraits de notre « personnalité
collective ». Chaque individu disposerait de la liberté,
et assumerait la responsabilité, de définir lui-même
la portée de ses attachements collectifs et de décider avec
qui il veut s'associer. Une utopie? Pas du tout, c'est ainsi que se vivent
les rapports entre individus dans la très complexe société
qu'est le cyberespace.
Dans une société libertarienne, les médias seraient
obligés de parler de choses importantes, pas des conflits artificiels
comme ceux qui monopolisent toute l'attention en ce moment. Il n'y aurait
plus d'État en crise, les problèmes comme les actions de
l'État interventionniste seraient privatisés et réglés
dans le contexte du marché libre. Les citoyens n'auraient plus besoin
d'être constamment « conscientisés », «
mobilisés », enrégimentés, pour des histoires
qui ne les concernent pas, ou qui n'existent que dans la tête de
collectivistes utopistes qui croient savoir mieux qu'eux comment ils doivent
vivre.
Dans une société libertarienne, il n'y aurait plus d'état
de crise permanent.
Martin Masse

Le Québec libre des
nationalo-étatistes
|
« Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses
puissantes mains chaque individu, et l'avoir pétri à sa guise,
le souverain étend ses bras sur la société tout entière;
il en couvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées,
minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus
originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient faire jour
pour dépasser la foule; il ne brise pas les volontés, mais
il les amollit, les plie et les dirige; il force rarement d'agir, mais
il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse; il ne détruit point,
il empêche de naître; il ne tyrannise point, il gêne,
il comprime, il énerve, il éteint, il hébète,
et il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un
troupeau d'animaux timides et industrieux, dont le gouvernement est le
berger. »
Alexis de Tocqueville
DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE
(1840) |
|