| Histoires en quête de personnages
Essayez de vous rappeler du dernier film canadien anglais que vous avez
vu. Hum... Ou bien vous n'avez pas de mémoire, ou bien vos souvenirs
ne vous plaisent pas particulièrement. Si rien ne vous vient à
l'esprit, ne vous en faites pas! Inutile de culpabiliser, vous faites partie
de la majorité, aussi bien québécoise que canadienne.
Les artisans qui oeuvrent dans ce domaine ont beau recevoir des tas de
trophées et faire l'objet de toutes sortes de reconnaissances un
peu partout dans le monde, rien n'y fait. Ce cinéma ne plaît
qu'à quelques intellectuels, critiques de journaux branchés
et membres de jurys d'obscures festivals internationaux. Mais pourquoi
ne plaît-il pas... aux Canadiens? Tentons l'autopsie.
Ce qui saute aux yeux, en premier lieu, c'est le caractère plutôt
austère des thèmes abordés dans le cinéma canadien.
Comme dans le cas des films tournés pour la télé présentés
à la CBC (voir: ANACHRONIQUE TÉLÉ PUBLIQUE,
le QL no 38), les histoires qui y sont
racontées sont souvent trop sombres ou tordues pour plaire à
un large public. Rarement elles sont légères. Encore moins
divertissantes. Et la plupart du temps, elles se terminent de façon
tragique ou tout simplement en queue de poisson.
Elles mettent en scène des personnages victimes de leur environnement,
qui réussissent rarement à obtenir ce qu'ils désirent
et qui ne sortent presque jamais transformés par ce qu'ils vivent.
Ces personnages sont bien souvent des marginaux et ont de la difficulté
à fonctionner en société. Loin d'être «
normaux », ils mènent des vies effacées dans
lesquelles ils accomplissent peu d'actions positives pour eux ou leurs
proches. Ils sont tantôt mentalement déséquilibrés,
tantôt socialement mésadaptés, tantôt sexuellement
perturbés, tantôt émotionnellement handicapés.
Difficile pour Monsieur et Madame Tout-le-monde de s'y identifier.
Et s'ils vont au cinéma ces Messieurs et Mesdames Tout-le-monde,
ce n'est certainement pas pour déprimer ou tenter de sonder les
profondeurs de l'esprit d'un auteur. Ils vont au cinéma pour se
changer les idées, pour passer le temps, pour s'évader du
quotidien, pour vivre des émotions fortes, pour socialiser, pour
meubler d'éventuelles conversations, pour assouvir leur côté
voyeur... pour voir leurs acteurs favoris. Car s'ils vont au cinéma,
c'est aussi pour les voir évoluer sur écran géant.
L'importance de l'étoile
Le cinéma d'auteur, comme son nom l'indique, est un cinéma
dont le succès repose sur la notoriété de son réalisateur
et non sur celle de ses acteurs. S'il a connu de belles années,
de façon générale, c'est de moins en moins vrai. Et
ce, à travers le monde. Ce qui se fait maintenant, c'est du film
« d'acteurs ». On ne va plus voir le dernier Polanski
ou le dernier Scorsese. Avec les années, la popularité des
réalisateurs a été remplacée par celle des
acteurs. On va voir le dernier De Niro ou le dernier Depardieu. Cette nouvelle
réalité repose sur un star system bien établi.
|
« Malgré
toutes les centaines de millions de dollars qui nous sortent des poches,
on n'est pas foutu de nous présenter des films qui vaillent la peine
d'être vus. »
|
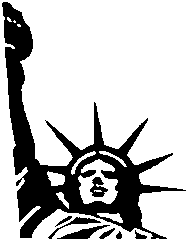
|
Si le Québec possède son star system, on ne peut pas
en dire autant du Canada anglais. Rien qu'à voir l'accueil qu'ont
réservé les chroniqueurs anglophones à Julie Snyder
et son émission Le poing J lorsque le réseau TVA est
devenu national, on comprend mieux le manque. Leur message en substance:
le Canada anglais a besoin d'un Poing J. Un talkshow où
les vedettes viendraient ploguer leur dernier projet, l'un à
la suite de l'autre. La formule peut sembler simpliste, mais combien révélatrice.
Pour diffuser une telle émission, encore faut-il avoir des invités
à présenter.
Bien sûr le Canada anglais a ses stars du cinéma. Mais, elles
sont trop souvent du mauvais côté de la caméra. Les
stars du Canada anglais sont les réalisateurs, les scénaristes,
les artisans... les Atom Egoyan, David Cronenberg, Don McKellar, etc. Des
gens que vous ou votre mère croiseriez dans la rue sans jamais les
reconnaître. Il y a très peu de comédiens qui jouissent
d'un semblant de notoriété en dehors du Québec. Comment
se constituer un auditoire alors sans spectacle à présenter?
Les films du Canada anglais manquent donc d'histoires attrayantes et de
comédiens reconnaissables. Un manque total d'attrait. Et contrairement
à la ministre Copps qui nous les casse depuis quelques années
avec ses histoires canadiennes, personne ne se lève le matin en
se disant: « Chérie, on devrait aller voir un
bon film canadien ce soir. » Ou: «
Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas vu un film canadien
moi! Je serais dû. » Le nationalisme ne fait pas
nécessairement du bon cinéma. Les projets privilégiés
par nos bureaucrates non plus.
Mettre fin au cinéma «
dépendant »
Si les produits culturels américains sont souvent moyens, ils ont
l'avantage d'être financés par le secteur privé. S'ils
n'attirent personne et ne font pas leurs frais, ça n'a de répercussions
que sur une poignée d'investisseurs. Au Canada, tous les produits
culturels sont financés par le secteur public. Et quand ils ne font
pas leurs frais, c'est l'ensemble des contribuables qui écopent.
Chaque année, des centaines de millions $ de nos taxes
y passent – il faut bien que quelqu'un paye pour tous ces programmes d'aide
au cinéma, à la télévision, aux magazines,
aux éditeurs, aux entreprises, aux producteurs de cédéroms,
aux musiciens...
Pourtant, on ne voit pas le centième de ce qui se fait en art au
Canada. Et malgré toutes les centaines de millions de dollars qui
nous sortent des poches, on n'est pas foutu de nous présenter des
films qui vaillent la peine d'être vus. On nous prend tout cet argent
pour financer un cinéma d'auteur destiné à un minuscule
auditoire de quelques centaines de personnes bien « profondes
» qui autrement ne pourraient pas se payer ce genre de cinéma
trop « songé » pour la masse.
À part ces quelques centaines de personnes, tout le monde y perd.
Vous et moi avec l'argent qu'on nous soutire, et les cinéastes avec
les entraves que le système leur impose. Prenez le cas de Pierre
Falardeau(*) au Québec. Depuis des années,
il tente de tourner son film 15 février 1839 sur le patriote
de Lorimier mort pendu. Le cinéaste est séparatiste. Le gros
du financement vient d'Ottawa. Les politiciens ont beau dire que leurs
organismes sont politiquement neutres, on n'encourage pas la réalisation
d'un produit dont le seul but est de nous discréditer – c'est vrai
pour Ottawa, c'est vrai pour le Québec. Alors des pressions sont
exercées, des décisions sont adoptées, et les projets
sont rejetés.
Souvenez-vous de la controverse entourant les films Bubbles Galore
et The Girl who would be King, deux films canadiens subventionnés
et mettant en vedette 1) une pornographe féministe qui tente de
redorer l'image de la femme dans l'industrie du film porno et 2) une lesbienne
du genre « drag king » à
la recherche de ses propres parties génitales (c'est dans le synopsis).
Comme à l'habitude, Sheila Copps est tombée des nues en apprenant
à quoi avait servi l'argent des contribuables. Pressée de
s'expliquer à la Chambre des communes, elle a déclaré:
« This is certainly one of these very serious cases
where I would very much like to shorten the arm's-length relationship that
exists with the Canada Council and other agencies. »
Indépendants vous dites!
Dans un marché privé, ces réalisatrices n'auraient
pas à justifier leurs choix artistiques ou à expliquer –
en trois exemplaires SVP – les motivations profondes du personnage principal
de leurs contes érotico-pornos. Elles trouveraient des gens qui
croient en elles, en leur projet et qui ont à coeur ce genre de
productions. Même chose pour M. Falardeau. Il n'aurait pas à
attendre indéfiniment qu'une poignée de bureaucrates s'entendent
sur l'atteinte du consensus avant de mener à terme son projet. Il
trouverait du financement auprès d'entreprises ou d'individus avec
qui il partage (ou pas) certains idéaux et qui sont prêts
à investir quelques centaines de milliers de dollars dans un film
moyennant un quelconque exposure. Et de leur côté,
les contribuables n'auraient pas à faire de l'urticaire en apprenant
que l'argent de leurs taxes sert à financer des produits douteux
qu'ils ne voudraient pas que leurs enfants voient.
Vers un culture connectée
Le cinéma canadien n'est pas populaire parce qu'il est subventionné.
Les bureaucrates des nombreux organismes gouvernementaux attitrés
à la culture qui privilégient tel projet plutôt que
tel autre sont déconnectés des réalités du
marché et ne recherchent pas nécessairement le profit ou
la performance d'un produit culturel.
Les cinéastes gagneraient à se défaire de leur dépendance
de l'État et à établir des liens avec le secteur privé.
Leurs intérêts seraient mieux servis par des investisseurs
qui croient en leurs films et qui espèrent de bonnes recettes au
box office que par une bande de bureaucrates qui ne sont qu'affectés
à des dossiers. L'homme d'affaires qui oeuvre dans le secteur privé
est beaucoup plus près de la réalité du consommateur
cinéphile que n'importe quel fonctionnaire à l'emploi assuré
et à la convention collective de béton armé.
« Oui, mais le secteur privé n'a jamais encouragé
la culture », répliquera-t-on. Pourtant, on ne
peut attribuer la naissance du cinéma aux bons gros gouvernements
interventionnistes. Bien avant que ne soient mis sur pied les divers départements
de la culture et programmes d'aide à la création que l'on
connaît aujourd'hui, il se faisait du cinéma dans le monde.
Il suffirait que l'État se retire du secteur de la culture pour
que le privé se découvre de nouvelles affinités avec
celui-ci. Il suffirait que l'un se retire pour que l'autre y trouve son
compte.
Sortie du carcan du système de financement par l'État, la
culture serait plus dynamique et plus près des réalités
de ceux qui la consomment. Libérés du cercle restreignant
de la demande de subvention, les créateurs pourraient mieux interagir
et surtout réagir plus rapidement. Bien sûr, certains projets
ne verraient pas le jour, mais ce que nous perdrions en quantité,
nous le regagnerions en qualité. Après tout, une culture
ne se mesure pas au nombre de produits qui la composent. Elle se mesure
à l'appréciation qu'on lui porte.
(*) Pierre Falardeau: (Montréal,
1946) Cinéaste québécois qui réalise des films
dénonciateurs
dont les personnages sont toujours victimes de quelque chose (le méchant
système capitaliste...
les méchants fédéralistes... les méchantes
polices... les méchants riches... vous voyez le genre.)
>>
Articles précédents
de Gilles Guénette |