|
| Montréal,
le 17 juillet 1999 |
Numéro
41
|
 (page 2)
(page 2) |
 page précédente
page précédente
Vos
réactions
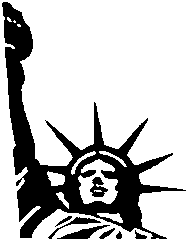
Le QUÉBÉCOIS
LIBRE est publié sur la Toile depuis le 21 février 1998.
Il défend
la liberté individuelle, l'économie de marché et la
coopération volontaire comme fondement des relations sociales.
Il s'oppose
à l'interventionnisme étatique et aux idéologies collectivistes,
de gauche comme de droite, qui visent à enrégimenter les
individus.
Les articles publiés
partagent cette philosophie générale mais les opinions spécifiques
qui y sont exprimées n'engagent que leurs auteurs.
|
|
|
ÉDITORIAL
QUEL SALAIRE MÉRITENT
LES INFIRMIÈRES?
par Martin Masse
Après trois semaines de grève illégale, les infirmières
du Québec ont rejeté une entente de principe conclue pendant
une trêve entre leur syndicat, la Fédération des infirmières
et infirmiers du Québec (FIIQ) et le gouvernement provincial. Au
moment d'écrire ces lignes, des négociations ultimes sont
en cours et on ne sait pas comment le conflit va se régler. Mais
quoi qu'il arrive avec les infirmières, la crise dans la santé
n'est, elle, pas près de se résorber.
Les infirmières ont-elles eu raison de défier la loi pour
obtenir de meilleurs salaires et conditions de travail? Les citoyens qui
les appuient et qui subiront des hausses d'impôt pour financer des
gains salariaux se font-ils berner? Les infirmières sont, on n'en
doute pas, bien bonnes, bien dévouées, et sûrement
surchargées de travail, mais qui n'a pas de bonnes raisons pour
exiger une rémunération plus élevée?
On aura beau discuter ad vitam aeternam des qualités des
infirmières, celles-ci travaillent dans le but d'offrir un services
à des consommateurs de soins de santé. La seule façon
de savoir ultimement le salaire qu'elles méritent, c'est de déterminer
ce que les consommateurs sont prêts à payer pour les obtenir,
comme pour n'importe quel autre produit ou service.
Mais dans le système actuel, où les conditions de travail
dans tous les hôpitaux de la province et les salaires de toutes les
infirmières sont négociées de façon centralisée,
il est tout simplement impossible de répondre à ces questions.
Il n'y a qu'un seul employeur et payeur, l'État, et à toutes
fins pratiques un seul employé, les organisations syndicales. La
détermination des salaires se fait donc non pas à partir
d'une évaluation des besoins et des priorités des citoyens
(comme un hôpital en concurrence avec d'autres hôpitaux pourraient
plus facilement le faire), mais plutôt à la suite d'un rapport
de force: jusqu'où les syndicats sont-ils prêts à aller
dans leurs moyens de pression? Quelles autres priorités politiques
le gouvernement devra-t-il sacrifier en cédant aux demandes de ses
employés? Laquelle des deux parties réussira le mieux à
manipuler l'opinion publique à son profit? |
|
Pénuries socialistes
Le
système est ainsi fait qu'on ne peut sortir de cette dynamique de
confrontation. La seule façon pour les employés de la santé
d'améliorer leur sort est de faire pression sur le gouvernement,
avec les coûts tragiques, pour le public comme pour eux-mêmes,
qu'une grève comme celle des derniers jours peut entraîner.
Ces rondes de négociation centralisée dans le secteur public,
avec des contrats échus en même temps aux trois ans, qui mènent
aux « fronts communs » et aux affrontements de
façon presque aussi prévisible que le retour des hirondelles
au printemps, constituent l'un des aspects les plus débilitants
du « modèle québécois »
étatiste et interventionniste.
Les infirmières ne sont d'ailleurs pas les seules à souffrir
de cette gestion socialiste. À peu près toutes les professions
du monde médical présentent les mêmes symptômes:
pénurie d'effectifs, surmenage et démoralisation du personnel,
manque d'équipement spécialisé, salaires inférieurs
à ceux qui ont cours ailleurs en Amérique du Nord. Ces derniers
mois, on a pu entendre les mêmes doléances de la part des
ambulanciers, des urgentologues, des médecins en région,
des pharmaciens en établissement, des rhumatologues, des radio-oncologues,
etc.
Comme dans les pays communistes, où les citoyens devaient faire
la queue pour acheter du pain dans les boulangeries d'État, ce sont
les pénuries qui caractérisent inévitablement la gestion
bureaucratique de la santé. L'envoi de patients cancéreux
pour se faire traiter aux États-Unis, parce que les listes d'attente
sont trop longues dans les hôpitaux d'ici, marque un tournant dans
la lente et graduelle déliquescence du système de santé
québécois depuis sa nationalisation il y a près de
trente ans.
Mieux planifier
Un gouvernement qui intervient partout finit nécessairement par
frapper un mur sur le plan fiscal. Même si nos politiciens ont mis
bien du temps à s'en rendre compte, et viennent à peine d'accepter
la réalité des dettes et des déficits, il y a des
limites à ce que l'État peut dépenser. Par définition,
la gestion bureaucratique coûte plus cher et est moins efficace qu'une
gestion fondée sur la discipline du marché. Le gouvernement
a donc vu les coûts de la santé se gonfler au cours des ans
et, pris de panique, a tenté de renverser la vapeur il y a deux
ans avec la réforme du ministre Jean Rochon. On a coupé à
gauche et à droite, envoyé des milliers de médecins
et d'infirmières à la retraite anticipée et changé
les procédures d'offre de soins pour les rendre plus «
efficaces ». On voit le résultat aujourd'hui, c'est
le désastre.
|
« Des
bureaucrates placés dans une situation de crise ne peuvent rien
faire d'autre que courir après leur queue comme des chiens excités,
sans se rendre compte qu'ils ne l'attraperont jamais. »
|
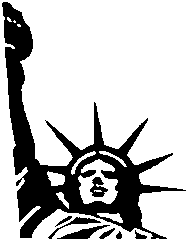
|
Du vérificateur général aux courriers des lecteurs
en passant par les fédérations de médecins, on entend
maintenant la même critique: « Le gouvernement
a mal planifié la réforme! » Personne
ne fait pourtant le bon diagnostic, qui est le suivant: un gouvernement
ne peut, par sa nature même, bien planifier quelque système
complexe que ce soit. Friedrich Hayek l'a magistralement démontré,
aucune bureaucratie centralisée ne possède l'information
nécessaire sur les besoins et désirs des individus, sur les
compétences des producteurs, sur l'efficacité des différentes
procédures, sur les prix futurs des multiples produits et services,
sur les changements technologiques potentiels, bref, sur tous les aspects
d'un marché, pour planifier le développement de tout un secteur
économique.
Mais il serait illusoire de demander à notre élite actuelle
de considérer une véritable réforme du système
de santé, ce qui impliquerait des privatisations et une décentralisation
radicale. Des bureaucrates placés dans une situation de crise ne
peuvent rien faire d'autre que courir après leur queue comme des
chiens excités, sans se rendre compte qu'ils ne l'attraperont jamais.
Un « plaster »
sur une jambe cassée
La Conférence des régies régionales de la santé
a ainsi proposé récemment, pour régler le problème
de l'encombrement des urgences et de la pénuries de médecins
spécialistes, de créer des « niveaux de
priorité » parmi les différents secteurs
du réseau de la santé. Par exemple, au lieu de payer tous
les médecins de la même façon à l'acte, ceux
qui travaillent dans des secteurs cruciaux comme les urgences ou la radio-oncologie
seraient mieux rémunérés. Mais qui va déterminer
ces secteurs prioritaires? Comment saura-t-on ce qui est prioritaire dans
une région et ne l'est pas dans une autre? Comment les priorités
pourront-elles changer de façon à suivre une situation médicale
en constante évolution? Dans un système de marché
libre, ce sont les prix à la hausse ou à la baisse qui permettent
de réguler ces changements. Mais dans un système étatisé,
ce seront encore des bureaucrates en possession d'information limitée
qui tenteront de planifier un système trop complexe pour être
appréhendé de cette façon simpliste et centralisée.
Il a aurait déjà plus de 80 bureaucrates à Québec
qui s'occupent exclusivement de gérer les multiples conventions
collectives et modes de rémunération dans le secteur de la
santé. Cette proposition des régies ne ferait qu'ajouter
à la complication du processus, sans modifier le problème
de fond, qui reste l'impossibilité de gérer un système
économique complexe sans avoir recours aux mécanismes de
marché. Pendant ce temps, le gouvernement continue à contingenter
l'accès aux facultés de médecine et croit pouvoir
déterminer dix ans à l'avance combien de jeunes médecins
il aura besoin.
C'est tragique de voir les choses se détériorer ainsi, de
voir des gens désabusés dans leur travail, et d'autres qui
souffrent, et même meurent, en attente de traitements. L'État
interventionniste et collectiviste ne recule pas devant quelques morts,
même s'il nous abreuve constamment de notions de « solidarité
» et de « compassion ».
Sans réforme véritable, la situation ne pourra qu'empirer
dans les années qui viennent. Le gouvernement pourrait bien sûr
nous taxer un peu plus et consacrer ces ressources au renflouement d'un
système inefficace, mais ce serait l'équivalent de mettre
un « plaster » sur une jambe cassée.
Même si la crise actuelle se résorbe, soit par un recul de
Québec, soit par une capitulation des infirmières, il y aura
encore des urgences bondées l'hiver prochain et il manquera toujours
de médecins en Abitibi. C'est tragique, mais il faudra probablement
attendre que le système s'effondre sous le poids de ses contradictions,
comme l'ont fait les régimes communistes, avant qu'on puisse voir
des changements.
Articles précédents
de Martin Masse |

Le Québec libre des
nationalo-étatistes
|
« Après avoir pris ainsi
tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu, et l'avoir
pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur
la société tout entière; il en couvre la surface d'un
réseau de petites règles compliquées, minutieuses
et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux
et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient faire jour pour dépasser
la foule; il ne brise pas les volontés, mais il les amollit, les
plie et les dirige; il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse
à ce qu'on agisse; il ne détruit point, il empêche
de naître; il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il
énerve, il éteint, il hébète, et il réduit
enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux
timides et industrieux, dont le gouvernement est le berger. »
Alexis de Tocqueville
DE LA DÉMOCRATIE EN AMÉRIQUE
(1840) |
|