| L'avenir est sombre... nous l'avons vu
La culture se porte mal. C'est d'entrée de jeu ce qu'écrit
la rédactrice en chef du magazine, Marie-Claude Loiselle. À
qui la faute? Au marché, bien entendu. À l'Économisme
(remarquez le gros « É »), «
cette idéologie qui fait qu'un musée accepte d'exposer
la voiture d'un commanditaire dans son hall, qu'un livre quitte les rayons
des librairies après un mois s'il ne fait pas partie des best-sellers,
qu'un théâtre verra ses subventions réduites s'il ne
prend pas tous les moyens pour appâter les chalands et qu'un film
sera retiré de l'affiche après deux semaines s'il ne fait
pas courir les foules. »
Quand les intellectuels se prononcent sur l'état de la culture,
c'est souvent pour dire que tout va mal. Peut-être connaissent-ils
plusieurs artistes en attente de subventions ou carrément dans la
dèche qui doivent se « prostituer », comme
ils disent, pour arriver à joindre les deux bouts, toujours est-il
que l'optimisme culturel n'est pas pour eux. C'est pour les naïfs,
ceux qui manquent de perspective sur les choses. Car contrairement à
nous, pauvres mortels, ces gardiens de l'intégrité culturelle
sont conscients des « reculs » qui s'opèrent
sur notre planète. Ils sont de gauche, ils ont le mal de vivre et
ils s'opposent à tout ce qui a trait de près ou de loin au
marché.
Donc, les six personnes qui collaborent à ce dossier disent toutes
sensiblement la même chose: la situation est catastrophique, il ne
semble pas y avoir de solution en vue et les maudits Yankees nous les cassent
avec leur McCulture – étrangement, le fait que les artistes québécois
soient présents en très grand nombre sur la scène
internationale ne semble pas les émouvoir outre mesure. Il serait
futile de rapporter ici tous ces propos, vous les avez entendus mille fois.
Mais deux articles méritent toutefois qu'on s'y attarde un peu:
une réflexion sur la transformation de la culture en distraction
avec le penseur français Alain Finkielkraut(1)
et une « mise en perspective » de
Normand Baillargeon sur l'avenir de la culture dans un monde dominé
par le discours... libertarien(2).
La menace mondialisatrice...
Sur les nombreux points de vue mis de l'avant dans ce dossier, le seul
qui soit un tant soit peu pertinent et nuancé est celui de Alain
Finkielkraut. Même lorsque la rédactrice en chef du 24
images tente de le faire glisser vers un discours alarmiste en lui
parlant du devoir de l'artiste de résister à l'uniformisation
et à la mondialisation de la culture, le penseur surprend avec une
position qui va à l'encontre du discours culturel officiel:
« Il ne s'agit pas de se placer dans une posture de
résistance à quoi que ce soit. Le problème, à
mon avis, ne se pose pas en ces termes. Il faut d'abord savoir ce qu'on
a à dire, et c'est tout; et ce qu'on a à dire dépend
justement de l'expérience qui nous a constitué. Dans cette
optique, la volonté de créer des produits internationaux
apparaît totalement absurde. Même les meilleurs écrivains
américains n'écrivent pas une littérature internationale.
Il n'y a rien de plus local que le roman américain, qu'il s'agisse
d'un Faulkner ou d'un Philip Roth, il y a même de quoi être
fasciné, dans ce pays immense, par le “localisme” des écrivains
les plus universels. (...) La question n'est ni de résister à
la mondialisation ni de se replier sur son identité, mais avant
tout de faire fond sur son trésor personnel. »
Inutile de craindre ou de repousser la mondialisation, il faut s'en servir.
Au lieu de la voir comme une sorte de rouleau compresseur américanisant
dont il faut à tout prix se protéger, les intellos de la
culture devraient en voir les bons côtés. L'ouverture des
marchés et la révolution numérique permettent aux
créateurs d'exporter leurs produits partout sur le globe et aux
consommateurs de tous les continents d'y avoir accès. Les créateurs
qui réussissent à se démarquer sont justement ceux
qui savent tirer profit de cette mondialisation. Ils savent s'adapter aux
nouvelles réalités de la communication et parler de leur
patelin d'une façon qui intéresse un plus large public.
|
« La
culture québécoise est florissante. Des entreprises comme
Cinar, La La La Human Step, Céline Dion, le Cirque du Soleil, Juste
pour rire... sont des leaders mondiaux dans leurs domaines respectifs.
»
|
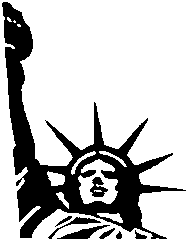
|
Mais la culture, peut-elle survivre « à la réalité
qui fait qu'un film est retiré des salles après deux semaines
s'il n'attire pas les foules et qu'un livre disparaît des rayons
après un mois s'il ne fait pas partie des best-sellers »?
Pour Finkielkraut, cette survie de la culture passe par l'éducation
et la « désactualisation » du discours
culturel. Le fait que tout bouge trop vite et que très peu d'oeuvres
laissent des traces significatives est, selon lui, le résultat d'une
évacuation du passé au profit d'un présent qui ne
met l'accent que sur ce qui émerge – par opposition à ce
qui s'est accumulé au cours des décennies. Cette situation
entraîne « une sorte de papillonnage par lequel
chacun fait son marché et a vis-à-vis de la culture le rapport
d'un consommateur impatient et distrait. » Et, ultimement,
elle fait en sorte que l'on se retrouve avec de plus en plus de ce qu'on
pourrait qualifier de fast food culturel; une multitude de produits
superficiels vite consommés et vite oubliés.
Une des solutions à envisager pour redresser la situation serait
de cesser de subventionner la culture – proposition que n'avance pas Finkielkraut,
on s'en doute. Car si l'interventionnisme permet à plus d'artistes
de s'exprimer, il contribue aussi à faire en sorte que très
peu d'entre eux se démarquent. Les subventions permettent l'existence
de produits qui autrement n'auraient peut-être pas vu le jour. Elles
créent une offre beaucoup trop importante pour la demande existante.
En bout de ligne, cela force les libraires, les disquaires et les propriétaires
de salles de cinéma à pratiquer un fort roulement des stocks.
La subvention, si bien intentionnée au départ, raccourcit
l'espérance de vie du roman, du disque, du film, etc., en créant
une compétition artificielle et donc nuisible.
La menace libertarienne...
« Les plus rigoureux de ces apôtres du marché
s'appellent les libertariens. Selon eux, c'est entendu, le marché
devrait régner partout... » C'est de cette façon
que Normand Baillargeon, chroniqueur au Devoir et professeur
au département des sciences de l'UQAM, fait son entrée en
matière. Contrairement à Finkielkraut, il adopte une position
culturelle plus officielle – tout est noir de ce côté-ci de
l'univers – à la différence qu'il fonde son argumentation
anti-marché sur la menace libertarienne.
Après avoir fait un bref survol de l'historique du «
mécanisme économique qu'on appelle le marché
» (Adam Smith, les années d'après-guerre, le
démantèlement du modèle keynésien, la course
à la déréglementation...), et être revenu sur
la foutue voiture du Musée des beaux-arts de Montréal – mais
qu'est-ce qu'ils ont tous à accrocher sur cette bagnole? L'exposition
est à l'étage, veuillez me suivre –, Baillargeon parle de
la montée du discours économique et du retrait de l'État
comme d'autant de reculs.
« Il apparaît pourtant que l'ordre (notamment
économique) actuel constitue un véritable assaut contre la
démocratie et contre l'idée même de participation du
public dans les affaires qui les concernent. Les acteurs majeurs de cet
assaut sont notamment les entreprises et les institutions économiques
qui les servent. » Eh oui! Tous nos problèmes
nous viennent de ce que Baillargeon, et Noam Chomsky, appellent «
les tyrannies privées ». Car selon l'idée
reçue, ce sont les entreprises – le marché – qui dictent
les moindres faits et gestes du citoyen/consommateur et non le contraire.
Pourtant, ces soi-disant tyrannies privées ont beau nous offrir
le monde sur un plateau d'argent, si nous n'en voulons pas, elles ne nous
dictent pas grand-chose! Et le marché n'est pas une force occulte
avec une volonté unique dont le seul but est d'écraser pour
mieux dominer! Le marché n'est qu'un processus qui résulte
d'innombrables échanges entre les entreprises et les individus.
Rien de moins, rien de plus.
Et les libertariens dans tout ça? Baillargeon y arrive lorsqu'il
confronte ses idées à celles de ces apôtres du néolibéralisme
sauvage! « Que dirait un libertarien à ce sujet?
Dans un ouvrage qui vient justement de paraître, In Praise of
Commercial Culture [voir ma recension: UNE VISION OPTIMISTE
DE L'ART, le QL, no 17 ], Tyler
Cowen soutient que l'art est par définition un objet commercial,
qu'il l'a au fond toujours été et qu'il est bien qu'il en
soit ainsi, tant pour les artistes que pour le public consommateur d'art.
Selon ce point de vue, les grands artistes du passé, Bach et Mozart
en tête, mais aussi Chaplin et tous les autres, furent des entrepreneurs,
tentant de gagner un public et de rentabiliser leurs productions. (...)
Vous n'êtes pas convaincu par cet argumentaire? Vous avez bien raison.
Il faut ignorer tout, tant de l'art, de la culture que du politique et
du sociologique pour faire de Bach un entrepreneur et réduire la
création à ses déterminants commerciaux. »
Mais qu'y a-t-il de mal à être un entrepreneur? Pourquoi faudrait-il
que Bach et les autres aient été des êtres complètement
déconnectés de la réalité du marché
de leur époque? Ces gens, à part le fait d'avoir été,
dans quelques rares cas, des génies, étaient des citoyens
comme vous et moi. Ils avaient des factures à payer, des familles
à faire vivre... Et pour plusieurs, vivre de son art voulait dire
exécuter des commandes, entretenir de bonnes relations avec leur
mécène, s'assurer d'une quelconque rentrée d'argent...
L'artiste subventionné par l'État est un spécimen
très récent dans la longue lignée de l'évolution
humaine.
Bien sûr les artistes ne font pas ce qu'ils font uniquement pour
l'argent – si tel était le cas, ils auraient choisi une carrière
en médecine ou en droit. On s'entend, l'artiste vit d'abord pour
la reconnaissance que son métier lui confère. Sa motivation
première n'est pas nécessairement d'amasser des montagnes
de biens ou de faire fructifier son argent, il veut partager avec le plus
grand nombre sa vision des choses. En ce sens, il n'a rien du conseiller
financier. Mais cela ne veut pas dire qu'il soit un être foncièrement
irrationnel et qu'il ne prenne pas de précautions pour maintenir
ou élargir son public.
Et puisque nous y sommes, pourquoi ne devrions-nous pas parler de «
produits » lorsqu'il s'agit de livres, de disques ou de films?
Qu'y a-t-il de si réducteur dans ce terme? « Produit
» n'est qu'un mot que l'on utilise pour désigner un
objet que l'on reçoit, donne ou s'approprie. Parce qu'on ne peut
les cueillir à même les arbres ou le sol, il faut que quelqu'un
quelque part défraie une somme d'argent pour en profiter. Dans ce
sens, le concert de l'OSM, ou celui des Rolling Stones, n'est qu'un véhicule
qui, une fois le prix de notre billet payé, nous emporte ailleurs
le temps de quelques pièces musicales. Idem pour le livre qui n'est
qu'un objet que l'on lit d'un trait ou en rafale et qui nous procure quelques
heures d'évasion ou de réflexion.
D'immixtion et d'infiltration
M. Baillargeon déplore le fait que le discours des produits ne soit
malheureusement plus réservé aux économistes et qu'il
s'immisce sournoisement dans le milieu culturel. Que dire... Cette semaine
encore, à la télé, le chanteur québécois
Bruno Pelletier parlant d'une tournée qu'il entreprenait en Angleterre
disait qu'il allait tâter le terrain anglophone, question de voir
s'il y avait un marché pour lui là-bas. Doit-on déduire
que l'emploi de ces mots réduit la portée ou l'ampleur de
son oeuvre? Les pessimistes de la culture diront que oui. Que cette infiltration
du milieu de l'art par le discours économique est une tendance lourde
qui ne laisse rien présager de bon. Mais enfin.
Si ça peut les réconforter, les libertariens aussi dénoncent
le discours économique... du moins, ils dénoncent un certain
discours... celui que nos politiciens utilisent lorsqu'ils nous parlent
d'« industrie culturelle » et de
« produits culturels ». Cette nouvelle
façon, peu originale soit dit en passant, de justifier leurs constants
« investissements » (Vous voyez! Ça créer
de l'emploi!) a beaucoup plus à voir avec une sorte d'opportunisme
politique qu'avec le libre marché ou la mondialisation.
Il faut être un peu déconnectés de la réalité
pour prétendre que la culture se porte mal. Comme il faut ignorer
tout du marché pour croire que dans l'éventualité
d'un retrait de l'État du secteur culturel, cette industrie s'effondrerait.
La culture québécoise est florissante. Les coûts de
production et de diffusion n'ont jamais été aussi bas. Des
entreprises comme les Éditions de la Courte Échelle, Cinar,
La La La Human Step, Céline Dion, le Cirque du Soleil, Juste pour
rire... sont des leaders mondiaux dans leurs domaines respectifs. Les citoyens/consommateurs
n'ont jamais eu autant de temps et d'argent à consacrer à
la culture.
Une industrie aussi solide n'aurait pas de difficulté à se
prendre réellement en main et se débarrasser de son addiction
pour la subvention. Les seuls qui souffriraient d'un tel retrait sont bien
entendu les artistes qui n'existent que parce qu'ils reçoivent de
telles subventions. Mais alors que certains se recycleront rapidement vers
quelque domaine connexe, d'autres n'auront qu'à restructurer leurs
opérations afin d'occuper l'espace qui leur revient vraiment.
1. Marie-Claude Loiselle, «
Entretien avec Alain Finkielkraut », 24 images,
no 98-99, Automne 1999. >>
2. Normand Baillargeon, «
Petite mise en perspective », 24 images,
no 98-99, Automne 1999. >>
Articles précédents
de Gilles Guénette |