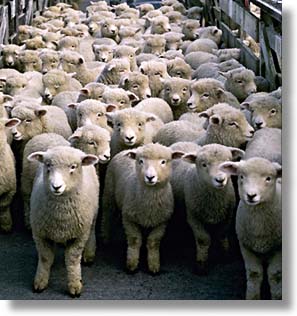Les débats creux du Bloc
Devant cette nouvelle impasse, les séparatistes s'en remettent donc
comme il y a quinze ans à leur passe-temps favori, les débats
théoriques creux et porteurs de divisions sur le sexe des anges.
Le Bloc québécois a ainsi mis sur pied il y a quelques mois
des « chantiers de discussion », dont l'un sur
le très pertinent sujet de la définition de l'identité
québécoise. Si l'on se fie au document produit et aux débats
que cela a suscité lors de leur dernier congrès, pour les
bloquistes, il faut mettre au rancart la notion de nation canadienne-française
au profit d'une nation québécoise « qui
inclut tous les citoyens ». Mais on précise quand
même que cette nation n'aurait pas de sens sans l'existence d'une
majorité nationale francophone ayant une langue, une culture et
une histoire communes et que cela est « compatible avec
la reconnaissance d'un pluralisme culturel au sein de la société
québécoise ». Bref, la nation québécoise
inclut théoriquement tous ceux qui vivent au Québec, mais
ceux qui parlent français sont un peu plus inclus que les autres,
ce qui n'exclut pas qu'on est tolérant et qu'on veut le pluralisme,
mais jusqu'à un certain point seulement, etc. etc.
On a aussi appris lors de ce congrès que le Bloc a décidé
de changer ses statuts pour se transformer en parti « permanent
» sur la scène fédérale, confirmant ainsi
que personne ne s'attend à la tenue d'un autre référendum
à court terme. « On s'enracine dans le combat
pour la souveraineté », a déclaré
le chef Gilles Duceppe. Bel euphémisme pour dire que ces pathétiques
deux de pique vont continuer à perdre leur temps à Ottawa
jusqu'à ce que le vent tourne. Les plus ambitieux, eux, quittent
le bateau. Lucien Bouchard a perdu son principal conseiller politique et
speechwriter, Jean-François Lisée, un des stratège
du référendum de 1995. Ce départ a fait beaucoup jaser,
M. Lisée ayant dit pendant la dernière campagne
électorale qu'il préférerait aller écrire des
romans s'il avait la certitude qu'il n'y aurait pas de référendum
durant le présent mandat.
En entrevue au Devoir, l'ancien journaliste et auteur a dit percevoir,
comme tout le monde, « qu'il y a en ce moment un certain
découragement général qui tient au cul-de-sac que
l'on constate. Et je comprends très bien que des gens puissent avoir
l'impression que c'est peut-être insoluble. Alors, ils se demandent:
à quoi bon mettre de l'énergie? Surtout qu'il s'en est dépensé
beaucoup d'énergie, depuis 30 ans, pour sortir le Québec
du cul-de-sac ».
Réalisme fiscal
La situation du 2e mandat Bouchard ressemble à celle du 2e mandat
Lévesque à d'autres égards. Dans les deux cas, le
contexte socio-économique favorise en effet un certain réalisme
fiscal qui s'accommode mal aux grands idéaux socio-démocrates.
Au début des années 1980, Ronald Reagan et Margaret Thatcher
appliquaient un frein aux politiques interventionnistes toujours plus ambitieuses
qui avaient plongé l'Occident dans une période prolongée
de ce qu'on a appelé la stagflation – c'est-à-dire
la stagnation économique couplée avec un taux d'inflation
élevé. Chez nous, confronté à une crise budgétaire
et à des demandes irréalistes de la part des mafias syndicales
du secteur public, le gouvernement péquiste imposait des coupures
de salaires qui allaient lui assurer un ressentiment profond de la part
de ses principaux supporters et une défaite aux élections
suivantes.
Pas besoin de réfléchir longtemps pour voir les parallèles.
Partout en Amérique du Nord, les gouvernements ont éliminé
leurs déficits et procèdent maintenant à des baisses
d'impôt. Comme les soi-disant « révolutions »
reaganienne et thatchérienne, la vague actuelle de réalisme
fiscal pourrait s'avérer très timide et ne réduire
en rien la taille de l'État. Mais le mouvement est quand même
réel et le gouvernement québécois se sent obligé
de suivre, même de façon timorée. Lucien Bouchard maintient
la ligne quant à son offre de 5% pour les hausses de salaires des
employés du secteur public et, après un affrontement avec
les infirmières au cours de l'été, c'est une lutte
plus corsée avec un front commun de toutes les mafias syndicales
qui s'annonce pour l'automne.
|
« Le
problème des nationalo-gauchistes est qu'ils n'arrêtent pas
d'ausculter notre corps collectif et d'y voir les pires symptômes.
»
|
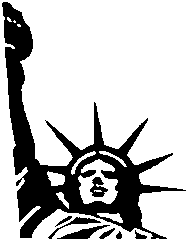
|
Deux sondages récents dans le National Post nous apprennent
par ailleurs des choses intéressantes sur l'état d'esprit
des Québécois. Alors que la crise du système de santé
public s'amplifie de mois en mois et qu'une contestation du monopole étatique
se poursuit devant les tribunaux (voir l'article de Jean-Luc Migué,
p. 11), l'appui à cette
vache sacrée du nationalisme canadien s'effrite. 41% des Canadiens
ne font plus confiance au système actuel et se disent en faveur
d'un plus large accès à des services privés. Fait
surprenant toutefois, il n'y a qu'au Québec qu'une majorité
se dégage en faveur de privatisations, avec 52% d'appui. Sur un
autre sujet crucial, le niveau d'imposition, les résultats sont
similaires. Un peu plus de la moitié des Canadiens considèrent
qu'ils paient trop d'impôts par rapport aux services qu'ils reçoivent
du gouvernement. Mais le sondage nous indique que cette attitude est partagée
par presque les deux tiers des Québécois. Pour une population
souvent décrite comme une tribu homogène où règne
le « consensus » sur la nécessité
d'avoir un État fort et interventionniste, le scepticisme à
l'égard de ce même État paraît étonnamment
élevé.
Pour ceux qui rêvent encore d'une alliance entre toutes les «
forces progressistes » de la province pour atteindre
les buts que sont l'indépendance et un socialisme toujours plus
poussé, le spectacle ne doit pas être beau à voir.
Les pauvres nationalo-gauchistes sont tellement déprimés
que certains craquent, comme d'autres le faisaient il y a une quinzaine
d'années. À l'époque, le ministre péquiste
Claude Charron détruisait sa carrière politique en volant
un manteau chez Eaton; plus récemment, l'hystérique présidente
de la Centrale des enseignants, Lorraine Pagé, connaissait le même
sort après des accusations (toujours contestées devant les
tribunaux) de vol de gants chez La Baie.
Il suffit de lire les lamentations de la passionaria nationalo-gauchiste
par excellence, Josée Legault, pour se rendre compte à quel
point ils broient du noir. Dans une chronique à The Gazette
intitulée « Clarkson brightens dreary week
», elle ne trouve que la nomination de cette autre nationalo-gauchiste
– nationaliste canadienne dans ce cas –, Adrienne Clarkson, au poste de
gouverneure générale du Canada, pour faire contrepoids à
une série de nouvelles déprimantes. Parmi celles-ci, elle
cite la contestation devant les tribunaux du monopole de l'État
dans la santé évoquée plus haut, un sondage montrant
que les Québécois préfèrent des baisses d'impôt
à des dépenses accrues dans la santé et l'éducation,
ou encore le fait que Lucien Bouchard ne semble pas du tout prêt
à tenir un référendum dans un avenir rapproché.
Malades imaginaires
Les nationalo-gauchistes sont de grands malades imaginaires et on ne devrait
pas trop s'en faire pour leur santé mentale chroniquement instable.
Leur problème est qu'ils n'arrêtent pas d'ausculter notre
corps collectif et d'y voir les pires symptômes. Par rapport à
la santé parfaite que constituerait leur utopie, la nation est en
effet toujours souffreteuse, handicapée, retardée dans sa
croissance, gênée dans son épanouissement. Mais ce
cul-de-sac, ce blocage collectif qu'ils diagnostiquent, n'existe que dans
leur tête. La nation n'a pas d'état de santé, les caractéristiques
qu'ils lui attribuent ne sont que des mythes collectivistes sans fondements.
Il n'y a qu'une chose réelle: c'est la capacité des individus
à s'épanouir, à atteindre leurs buts, à s'enrichir,
à créer, à apprendre, à entreprendre. Pour
faire tout cela, ils doivent être libres. La vraie maladie du Québec,
c'est l'étatisme, ce sont toutes les entraves que l'État
impose à l'épanouissement individuel.
Il y a donc un remède bien simple pour remettre le Québec
sur les rails: démanteler l'infrastructure bureaucratique de l'État
et libérer l'esprit d'entreprise et la créativité
des Québécois. Ce n'est pas ainsi que les nationalo-gauchistes
voient les choses évidemment. Pour eux, seuls les luttes populaires,
les buts collectifs, les bouleversements politiques, les grands symboles
nationaux, les interventions étatiques et les lois uniformes qui
s'imposent à tous, servent à avancer le bien-être d'un
peuple. Pour eux, les efforts de chacun pour améliorer son sort
et prendre sa destinée individuelle en main ne sont que des actions
triviales, lorsqu'elles ne vont pas carrément à l'encontre
de l'intérêt collectif.
Qu'on ne se méprenne donc pas. Le blues de nos élites nationalo-gauchistes
est un signe positif pour le Québec et il faut s'en réjouir,
le temps qu'il durera. Il faut prendre avec un grain de sel tous ces discours
grandiloquents sur notre impuissance nationale, qui ne sont que pure propagande
collectiviste. Le spleen idéologique est une constante dans les
débats au Québec(1) et cela n'est pas
prêt de changer. Reste à voir maintenant si les remises en
question actuelles permettront d'enclencher une nouvelle dynamique ou si
nous ne suivront pas le même parcours politique débilitant
que lors du dernier cycle.
1. Voir ma CHRONIQUE
D'UNE MORT ANNONCÉE publiée il y
a cinq ans dans Le Devoir.
Articles précédents
de Martin Masse |