| Montréal, 8 - 21 janv. 2000 |
Numéro
53
|
Vos commentaires 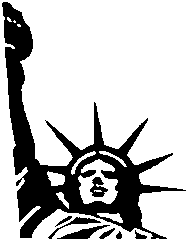
Les dépenses publiques au Canada, en pourcentage du PIB: 1926 15% 1948 21% 1966 30% 1996 46% (Source: Statistique Canada) |
par Pierre Desrochers
Le magazine télévisé Le Point présentait récemment une série de trois reportages sur Le contrôle économique d'une petite élite L'ancien président-fondateur du Groupe Lavalin, Bernard Lamarre, soutient qu'une petite élite d'une centaine de familles contrôle la France, tandis qu'aux États-Unis 150 ou 200 familles feraient la pluie et le beau temps. Prenons le cas américain. Henry Ford, Nelson Rockefeller, Andrew Carnegie et la plupart des autres grands industriels américains du tournant du siècle n'étaient ainsi pas issus de la bourgeoisie industrielle de la Nouvelle-Angleterre ou des grandes plantations du Dixieland. De plus, si les fortunes de leurs descendants demeurent considérables, il y a maintenant plusieurs années qu'elles ont été dépassées par celles des nouveaux riches de l'informatique et des télécommunications, de même que par certaines familles issues de régions souvent reculées oeuvrant dans des domaines plus traditionnels, telles que les Walton de l'Arkansas (Wal-Mart) et les Koch du Kansas (Koch Industries – exploitation pétrolière, bétail, aliments pour animaux, etc.). |
|
Les économies caractérisées par l'influence dominante
d'une petite élite sont bien plutôt celles du Tiers-Monde
où les industriels et commerçants proches du pouvoir se font
accorder toutes sortes de privilèges pour se protéger de
la concurrence. Dans une véritable économie de marché,
les seuls décideurs faisant et défaisant les grandes fortunes
sont les consommateurs qui choisissent un produit ou un service au détriment
d'un autre. Les héritiers Steinberg et Eaton n'y peuvent rien.
Le Québec, une mine de capital de risque La grande disponibilité du capital de risque québécois – qui représenterait selon certains calculs plus de 50% des fonds de ce type disponibles au Canada – est l'une des réalisations dont les partenaires socio-économiques sont les plus fiers. Il est toutefois loin d'être certain que la richesse que les fonctionnaires confisquent auprès de certains individus et entreprises prospères pour la rebaptiser Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le Confrontés au refus de la plupart des financiers de Détroit qui ne croyaient pas en son projet, Henry Ford dût miser sur les capitaux fournis par un charpentier, de petits hommes d'affaires et un commis de bureau. Ces investissements hors des circuits financiers habituels proviennent parfois d'individus ayant hérité de leur fortune. Ils sont toutefois le plus souvent l'oeuvre de gens d'affaires expérimentés prêts à investir quelques dizaines de milliers de dollars dans un projet qu'ils jugent intéressant et (peut-être surtout) dans des individus crédibles, entreprenants et débrouillards. Paradoxalement, la culture du capital de risque
De toute façon, comme le rappellent toutes les études sur le sujet, les fonds de capitaux de risque ne constituent que la pointe de l'iceberg du financement hors des institutions bancaires. Les La réforme du système d'éducation Le dernier point sur lequel j'aimerais revenir est celui de la réforme du système d'éducation. Les ratés du modèle québécois dans le domaine sont bien connus(2). On doit cependant corriger l'idée reçue selon laquelle le secteur privé serait resté passif devant une pénurie critique de main-d'oeuvre qualifiée. Ce que l'on doit absolument souligner, c'est que l'on a toujours observé dans les économies prospères une floraison d'institutions privées enseignant des choses pratiques, allant de l'alphabétisation à la comptabilité et aux techniques de pointe. Il est ainsi de notoriété publique que l'alphabétisation des populations américaines et britanniques a été accomplie bien avant l'intervention des gouvernements dans le domaine au 19e siècle – le plus souvent par le biais d'églises et d'organismes à but non lucratif(3). On constate également une croissance remarquable depuis quelques années aux États-Unis d'institutions privées à but lucratif dans une foule de domaines allant des sciences commerciales en passant par la coiffure et les techniques de pointe. C'est ainsi que le DeVry Institute, une compagnie à but lucratif dont les actions sont transigées en bourse, forme chaque année plus de La persistence et la popularité grandissante des institutions techniques et commerciales américaines sont d'autant plus remarquables que les divers paliers de gouvernement américains investissent depuis des décennies des sommes considérables dans leurs réseaux universitaires publics et dans les community colleges. Il est toutefois entendu que la formation en En fin de compte, la formation la plus importante que les individus reçoivent demeure typiquement celle qu'ils acquièrent sur leur lieu de travail. On estime ainsi que plus de 47 millions de travailleurs américains ont reçu une formation formelle de la part de leur entreprise ou de consultants externes en 1994 au coût approximatif de Le crépuscule du Comme l'a souligné le directeur de ce web magazine dans l'un de ses éditoriaux (voir LA REMISE EN QUESTION DU MODÈLE QUÉBÉCOIS, le QL, no 39), le modèle québécois n'a rien d'un modèle et n'a rien de québécois. Il ne constitue qu'un ensemble de mesures interventionnistes similaires à celles que l'on retrouve un peu partout sur la planète depuis des siècles. Et comme partout ailleurs, les mesures mises en place dans la Belle Province n'ont pas livré la marchandise pour des raisons que les artisans du Québécois libre tentent d'expliquer à chaque parution. 1. Amar Bhidé, The Origin and Evolution of New Businesses, Oxford University Press, 1999. >> 2. Voir notamment Jean-Luc Migué, Étatisme et déclin du Québec: Bilan de la révolution tranquille, Éditions Varia, 1999 et Réjean Breton, Les monopoles syndicaux dans nos écoles et dans nos villes, Éditions Varia, 1999. >> 3. Terence Kealey, The Economic Laws of Scientific Research, St-Martin's Press, 1996, pp. 347-353. >> 4. Pour de plus amples détails sur cette problématique, voir Tyler Cowen et Sam Papenfuss, The Economics of For-Profit Higher Education, Working Paper 97-04, Department of Economics, George Mason University, 1999. >> Articles précédents de Pierre Desrochers |
|
|